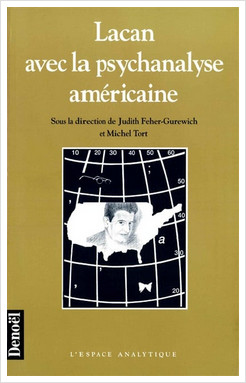
Par Aurelien - Le 22 Octobre 2025 - Source Blog de l'auteur
De toutes les avancées dans notre compréhension de l'esprit humain au cours du siècle dernier, aucune n'est plus fondamentale que la découverte de l'inconscient et la lente prise de conscience de son fonctionnement. Pourtant aucune n'a si peu d'effet sur notre façon de penser le monde. Cet essai porte sur ce qui pourrait arriver si elle en avait un peu plus.
En théorie, les idées de Freud (oui, je sais qu'il avait des prédécesseurs mais je n'ai pas l'espace pour tout couvrir, désolé) sont évidentes. Le modèle mécanique du fonctionnement du cerveau, l'hypothèse que l'esprit conscient est tout ce qui compte, ou même existe, la croyance qu'il y a une correspondance exacte entre la pensée et l'expression, et que nous disons ce que nous voulons dire, et signifie ce que nous disons, n'étaient plus tenables. Dans la vie quotidienne (où, ironiquement, les gens avaient toujours reconnu l'importance des confusions et erreurs verbales apparentes), il est devenu courant de parler de "dérapages freudiens", en anglais, et de lapsus révélateurs en français, même de la part de ceux qui n'ont jamais lu, ni même entendu parler de La Psychopathologie de la Vie quotidienne. Des générations d'étudiants en littérature ont été initiées à l'idée que le narrateur de Proust ne comprend pas toujours ses propres motivations, et que lorsqu'Antonio dans Le Marchand de Venise ne sait pas pourquoi il est si triste, c'est à cause de ses sentiments non reconnus pour Bassanio.
Ce n'est qu'en psychologie académique, paradoxalement, que l'idée de l'inconscient a été méprisée et rabaissée. Dans la première moitié du XXe siècle, la recherche psychologique portait sur le comportementalisme, et donc seul le comportement des gens importait, pas ce qu'ils pensaient. Le rejet irritable de Freud et du mouvement psychanalytique a été renforcé par le désir de faire de la recherche psychologique une science "dure", traitant de choses quantifiables et donc montrables sur des graphiques et des tableaux. Ce n'est que lentement que les psychologues se sont mis à étudier les processus mentaux, et ils ont finalement été obligés de prendre en compte les processus inconscients lorsque les expériences montraient que des choses se passaient dans le cerveau de sujets expérimentaux alors même que les sujets eux-mêmes en étaient totalement inconscients. Ce n'est que tout récemment que les psychologues en sont venus à accepter, à contrecœur, les idées de la psychanalyse et à reconnaître l'énorme importance de l'inconscient. Il est maintenant admis que l'inconscient est fondamental pour déterminer nos pensées et notre comportement, et que les processus mentaux inconscients sont en réalité très sophistiqués et adaptatifs, même si nous y sommes largement inconscients. En effet, certains psychologues sont allés jusqu'à suggérer que l'inconscient fait pratiquement tout le travail et qu'en fin de compte, la volonté consciente n'est peut-être qu'une illusion.
Pourtant, l'effet de cette reconnaissance sur la façon dont l'histoire, la biographie, la science politique et les experts en actualité sont écrits est proche de zéro, à quelques exceptions malheureuses dont nous parlerons plus tard. C'est pour le moins étrange. Il n'est pas question ici d'essayer d'ériger de nouvelles théories psychologiques élaborées pour expliquer les événements actuels ou passés ; seulement d'enregistrer l'idée que, maintenant comme par le passé, les décideurs et ceux qui écrivent à leur sujet peuvent agir ou parler pour des raisons dont ils ne sont pas entièrement conscients. Pourtant, à diverses occasions au cours des décennies où j'ai suggéré, dans la presse écrite ou en personne, que ces types de facteurs devraient au moins être reconnus, j'ai été reçu par de la simple incompréhension jusqu'au rejet irrité. C'est pour le moins curieux.
En partie, bien sûr, nous avons affaire au genre de scientisme vulgaire du XIXe siècle qui détermine encore la façon dont la plupart des gens pensent le monde. La vision matérialiste du monde, de plus en plus abandonnée au cours des dernières générations par les scientifiques eux-mêmes, a encore une forte emprise sur la pensée, même des personnes instruites. Elle a l'avantage de faciliter les explications générales, de nécessiter peu de connaissances sur des sujets tels que la langue et la culture (et, en fait, la psychologie) et de fournir des explications commodément réductrices pour à peu près tout ce qui se passe dans le monde. Les interprétations grossièrement matérialistes de l'histoire et des événements actuels se révèlent fausses ou incomplètes avec une régularité soporifique, mais elles restent aussi puissantes que jamais. Les experts supposent que les acteurs, même en cas de crise, se comportent avec une rationalité irréprochable et sont motivés par des motivations entièrement conscientes, la plupart entièrement matérialistes. C'est assez particulier.
Comme je l'ai déjà laissé entendre, cela s'explique en partie par le fait que c'est facile. Cette façon de penser s'inscrit confortablement dans les théories réalistes et néoréalistes du comportement de l'État, et dans de nombreux paradigmes rationnels des acteurs du comportement politique. Il joue bien avec les tentatives de réduire tous les comportements politiques à des facteurs économiques, ce qui a commencé avec le marxisme, mais ne s'est pas terminé avec lui. Et surtout, cela évite de penser que les acteurs politiques sont des êtres humains vivants et respirants avec leurs propres fragilités, désirs et besoins, plutôt que des découpes en carton agissant selon un modèle théorique. C'est l'équivalent en science politique des théories de l'acteur économique rationnel avec une information parfaite et, au moins en théorie, ouvre la voie pour enfin traiter le comportement politique avec la rigueur intellectuelle (fallacieuse) de la théorie économique. De plus, bien sûr, Freud est actuellement démodé, sans raison évidente autre que le fait qu'il soit né au XIXe siècle dans une société très différente et qu'il n'avait pas les mêmes pensées que nos élites culturelles contemporaines. Mais même ainsi, personne ne suggérerait sérieusement de nos jours que l'inconscient n'existe finalement pas. (Et de toute façon la psychanalyse en tant que discipline s'est considérablement développée au cours du siècle dernier.) Car le fait est que des motivations inconscientes jouent manifestement et sans ambiguïté un rôle dans la façon dont le grand public et les élites politiques conçoivent le monde et dans la façon dont ils essaient d'interpréter les événements.
Voici un exemple simple et classique, qui a été étudié par des historiens. Si vous regardez attentivement le langage utilisé par les partisans de la guerre en Ukraine, vous trouvez très rapidement l'argument selon lequel il faut "arrêter Poutine maintenant", ou quelque chose se passera dans le futur, sans savoir quoi. Cette injonction est répétée à l'infini par des pays souvent éloignés : (Paris qui est à environ 2500 km de Moscou, par exemple). Elle est même souvent répétée par des pays n'ayant aucun désaccord stratégique avec la Russie. Ainsi, la Grande-Bretagne et la France, parmi les plus alarmistes, entretiennent depuis longtemps des relations raisonnables avec la Russie. Ils ont pour la plupart été des alliés, et à part la courte guerre de Crimée, et le soutien de différentes parties dans certains conflits, leurs relations n'ont pas été particulièrement conflictuelles, selon les normes européennes. Il n'y a aucune raison logique pour qu'ils soient ennemis, encore moins qu'ils se combattent.
La réponse, bien sûr, réside dans les expériences des années 1930, et en particulier l'auto-flagellation que les classes politiques et intellectuelles britanniques et françaises se sont infligées presque immédiatement après l'accord de Munich en 1938, et de plus en plus une fois la guerre déclenchée. Des livres entiers ont été écrits sur « si seulement nous avions«, ou « si seulement nous n'avions pas«, ou « qui sont les Coupables ? » et, surtout, « cela ne doit plus jamais se reproduire«. Ceux qui, comme Churchill et De Gaulle, n'étaient pas au gouvernement à l'époque ont réussi à imposer un récit de faiblesse et de lâcheté face à l'agression qui a longtemps dominé le récit historique de la période et qui n'est en aucun cas encore éliminé. Et lorsque les Britanniques et les Français se lassent temporairement de l'auto-flagellation, les Américains sont toujours prêts à intervenir pour combler le vide. "Quelque chose", semble-t-il, aurait dû être fait, mais comme souvent dans de tels cas, ce quelque chose ne peut pas réellement être défini et ne progresse jamais au-delà du stade de « résister à l'agression » ou quelque chose de similaire. L'idée que d'une manière ou d'une autre, l'Allemagne aurait pu être persuadée ou contrainte d'accepter les dispositions de Versailles pour toujours, ou aurait pu se voir infliger une bonne raclée dans une guerre préventive rapide, continue de circuler, en l'absence de toute preuve à l'appui.
À ce stade, il est important de se rappeler que la chose la plus fondamentale, mais aussi la plus surprenante, à propos de l'inconscient est qu'il n'a aucune notion du temps. Il vit toujours dans le présent. Nous le savons par expérience personnelle : un traumatisme, une déception, une erreur de jugement d'il y a des décennies, s'ils ne sont pas traités, produisent les mêmes symptômes physiques et émotionnels aujourd'hui qu'à l'époque. Nous avons probablement tous rencontré des gens qui ont fait quelque chose qu'ils regrettent amèrement quand ils étaient beaucoup plus jeunes, et qui accomplissent inconsciemment des rituels d'expiation toute leur vie, comme si le passé pouvait ainsi être changé. Et bien sûr du point de vue de l'inconscient, où le temps est toujours à maintenant, ça pourrait l'être. Diverses thérapies existent pour tenter de mettre ces conflits au grand jour et peut-être de les dissiper, mais rien de tel, à ma connaissance, n'est disponible pour la classe politique occidentale.
Ce qui est frappant, c'est à quel point l'envie d'expiation dans ce cas était, au début, relativement visible et, au fil des décennies, a glissé imperceptiblement dans l'inconscient. Le manteau du nouvel Hitler et du nouveau régime nazi a été placé sur les épaules de destinataires improbables ; mais alors l'inconscient a sa propre logique particulière. À la fin des années 1940, il était largement admis, et fréquemment soutenu, que Staline répétait simplement le modèle de conquête territoriale d'Hitler, et qu'il fallait donc y mettre fin. Dans les années 1950, Nasser était le "nouvel Hitler" et sa philosophie de la Révolution était le nouveau Mein Kampf. Les Britanniques et les Français se félicitaient que l'opération de Suez ait au moins empêché la destruction par Nasser d'une grande partie de l'Afrique. Dans les années soixante, Patrice Lumumba fut le nouvel homme dangereux, tout comme on craignait que la victoire du FLN en Algérie n'ouvre la voie à une invasion soviétique du sud de l'Europe. La théorie des dominos qui a conduit à la guerre du Vietnam était essentiellement un exemple de cette façon de penser, tout comme la réaction occidentale à l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979, mais à ce stade, les réactions des dirigeants occidentaux avaient perdu tout contact avec les événements des années 1930, et était devenues largement inconscientes. Au moment des deux guerres contre l'Irak ou du bombardement de la Serbie, à mon avis, ces idées s'étaient à peu près entièrement retirées dans l'inconscient, ne laissant que des traces verbales errantes dans l'esprit conscient pour signifier leur présence.
Mais comme les analystes l'ont toujours dit, ce qui est vraiment important, ce n'est pas ce que les gens veulent dire, mais ce qu'ils disent réellement et ce qu'ils révèlent par inadvertance. La crise ukrainienne est un classique absolu, la quintessence de la façon dont des générations de culpabilité et de tentatives d'expiation, de l'abus de l'histoire à des fins politiques partisanes et de l'utilisation d'émotions enfouies comme excuses pour justifier les guerres partout ont finalement sombré si loin dans l'inconscient que les participants ne savent même plus pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Et en effet, tout observateur impartial devrait conclure que l'emballement de la crise ukrainienne est désespérément très mal dirigé du côté occidental par un groupe de dirigeants aux capacités très faibles qui, franchement, n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils font. C'est, bien sûr, une perspective effrayante si vous êtes un Occidental, et il est compréhensible que certains aient cherché du réconfort en imaginant un groupe anonyme obscur de manipulateurs qui savent ce qu'ils font, tandis que d'autres ont soutenu que, où que nous en soyons, ce moment était « le plan depuis le début«. (Je reviendrai sur l'origine de telles idées dans un instant.) Mais si vous y réfléchissez et que vous acceptez que la plupart de nos comportements dans notre vie quotidienne sont déterminés par des facteurs inconscients, cela ne devrait-il pas être au moins aussi vrai des crises politiques, avec leur panique, leur stress et leur manque d'information ?
Nous voici donc dirigés par des gens à peine conscients de ce qu'ils font et pourquoi, vivant une hallucination collective et jouant à prendre les décisions que leurs arrière-grands-parents auraient dû prendre mais n'ont pas fait. Ainsi, la « guerre » que certains dirigeants et experts occidentaux envisagent avec légèreté contre la Russie aujourd'hui est symboliquement la guerre d'agression non menée contre l'Allemagne de 1938-39, tout comme l'armement de l'Ukraine est une sorte d'expiation pour le fait de ne pas avoir envoyé d'armes au gouvernement républicain en Espagne pendant la Guerre civile : une action qui, selon de nombreux argumentaires (qui ont tort à mon avis), aurait pu empêcher la Seconde Guerre mondiale. Et pour ce que ça vaut, du côté de l'argument qui soutient la Russie, la motivation inconsciente est de combattre symboliquement la guerre préventive non menée qui aurait pu (et certains pensent qu'elle aurait dû) être déclenchée par Staline en 1941. Il y a des preuves que les dirigeants russes actuels sont motivés par ces mêmes impulsions inconscientes, mais je n'en sais pas vraiment assez sur la Russie pour en juger.
C'est tout ce que je vais dire directement sur l'Ukraine, car j'ai longuement couvert divers autres aspects de la question ailleurs. Je veux passer à des façons dont nous pourrions comprendre de manière plus générique l'influence de l'inconscient sur le psychisme des décideurs, avec des exemples ; mais d'abord un certain nombre de mises en garde sont nécessaires.
Pour commencer, mon argument n'a aucun rapport avec la psychologisation populaire des personnages historiques, comme si nous pouvions entrer dans leurs crânes. (« Qu'a dû penser Napoléon en partant vers Sainte-Hélène en 1816? » Nous n'en avons aucune idée et ce serait une perte de temps et d'efforts de spéculer.) Elle n'est pas non plus liée à la mode de psychanalyser en amateur les morts, comme dans les tentatives d'expliquer la Seconde Guerre mondiale par référence à l'enfance apparemment troublée d'Hitler. Et il n'est pas possible non plus d'essayer de construire une sorte de théorie générale de l'inconscient dans l'Histoire, précisément parce que le contenu de l'inconscient diffère d'une personne à l'autre, de même que les effets de l'inconscient et les circonstances dans lesquelles ces effets deviennent importants. De plus, la plupart des décisions politiques sont prises par des groupes (même si un chef a le dernier mot) et, presque par définition, le contenu de mon inconscient n'est pas le contenu du vôtre. Ce n'est que dans des cas comme celui ci-dessus, que j'ai appelé le syndrome de Munich, que vous pouvez parler de l'influence collective de l'inconscient à peu près dans la même direction et à la même échelle.
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas prendre à la légère l'inconscient : nous en avons besoin. Si chaque pensée, parole et acte devait être consciemment préparé et exécuté, nous ne pourrions pas vivre. La question est de savoir ce qu'il y a dans l'inconscient, si c'est dangereux dans un cas donné, et pourquoi ceux qui écrivent savamment sur les causes de la guerre ne considèrent jamais les idées de la psychologie, et se réfugient plutôt dans des banalités trompeuses sur l'instinct d'agression humain. L'influence de l'inconscient n'est pas toujours mauvaise, pas plus que les décisions qu'il propose, et pour lesquelles l'esprit conscient doit absolument trouver une justification, souvent fausse ou inadéquate.
Enfin, et surtout, le fait que les décisions soient en grande partie prises par l'inconscient ne signifie pas qu'elles sont nécessairement aléatoires ou irrationnelles. Après tout, il est assez clair que toutes les décisions et tous les discours sont influencés par l'inconscient, dans une certaine mesure. En effet, les psychologues nous disent que dans les cas extrêmes - paranoïaques, par exemple - ces processus peuvent être et sont souvent rationnels et cohérents. Vous pouvez vérifier tout cela en vous rendant sur n'importe quel site conspirationniste où des personnalités anal-rétentives avec trop de temps libre utilisent des arguments ingénieux et des recherches très détaillées pour essayer de nous convaincre que, disons, Paul McCartney est mort dans un accident de voiture en 1966 et a été remplacé par un sosie, ou que les Nazis, en 1945, se sont échappés en Antarctique en soucoupe volante.
Si vous acceptez l'hypothèse banale selon laquelle l'inconscient joue un rôle aussi important dans la prise de décision en cas de crise, dans l'écriture et la parole à ce sujet, que dans la vie de tous les jours, alors vous vous attendriez à y voir des schémas communs de la vie quotidienne répétés, et en effet c'est le cas. Quelques exemples simples suffiront. L'un d'eux est le simple aveuglement aux choses que nous ne voulons pas voir. Ainsi, amis et ennemis traitent toujours les États-Unis comme s'ils étaient une puissance militaire décisive en Europe, alors qu'en fait ils n'ont aucune force militaire capable de faire la différence dans les combats en Ukraine. C'est l'une de ces vérités gênantes dont nous décidons simplement de ne pas parler, comme le besoin imminent de rembourser un prêt ou quand la grosseur inquiétante que nous ne voulons pas reconnaître pourrait s'avérer maligne. L'inconscient nous protège de la nécessité de faire quoi que ce soit pour faire face à la nouvelle situation.
Un cas parallèle est notre capacité à oublier et à déformer des faits gênants, et à rester convaincu de leur vérité même sous pression. Diverses personnes qui étaient là à l'époque m'ont dit, par exemple, que le bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN était une réponse à l'expulsion des Albanais de souche, bien qu'un simple coup d'œil aux nouvelles du jour, sans parler de mes propres souvenirs, montre que c'est faux. Mais, inconsciemment, les gens inversent la cause et l'effet dans de telles situations pour paraître vertueux. Il y a beaucoup d'autres cas de "trous de mémoire" : un d'eux est la croyance désormais répandue que la Syrie n'avait pas d'armes chimiques en 2013, bien que le gouvernement ait admis en avoir, et qu'elles ont été retirées sous contrôle international. Dans les deux cas, l'inconscient fonctionne comme un puissant éditeur, façonnant et simplifiant nos souvenirs (comme le démontrent inévitablement les résultats misérables qu'entraine le fait de s'appuyer sur des preuves oculaires dans les affaires judiciaires.)
Un cas connexe est celui où l'inconscient se retire dans le désarroi à cause d'un problème trop important et effrayant à résoudre ou à comprendre. Il serait intéressant de savoir, par exemple, si les dirigeants mondiaux et leurs conseillers réunis lors des réunions de la COP sur l'environnement sont consciemment conscients de l'état du climat mondial et de ce qui risque de se passer. Il y a certaines choses qui sont tout simplement trop accablantes pour être assimilées, et notre inconscient les cache à notre conscience normale. J'y pensais récemment en lisant un certain nombre d'articles sur le cessez-le-feu à Gaza, qui se présentaient comme désintéressés et qui pourtant s'attardaient avec passion sur l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et sur la nécessité de s'assurer que le Hamas ne participerait pas au prochain gouvernement, tout en n'omettant pas de mentionner les morts palestiniens, même pour les minimiser. C'est l'inconscient qui garde hors d'atteinte des choses pénibles que l'esprit conscient ne veut pas traiter, et il y a fort à parier que de nombreux dirigeants européens et leurs conseillers sont probablement dans cette situation.
La question est alors de savoir s'il existe des façons de penser l'inconscient de manière plus organisée, et si nous pouvons nous appuyer sur le travail de quelqu'un qui en sait beaucoup plus que moi sur ces questions. Permettez-moi de suggérer qu'une partie du travail de Jacques Lacan pourrait être utile ici.
Il y a d'abord quelques avertissements à donner. Lacan était un penseur notoirement, et délibérément, complexe et difficile, qui a changé d'avis sur un certain nombre de questions importantes au fil des ans, et n'a pas cherché un large public, préférant limiter son auditoire à ses collègues professionnels. Il a peu publié de son vivant, et son héritage est une série de séminaires hebdomadaires au cours de la seconde moitié de sa vie, par la suite dactylographiés et publiés lentement sous forme éditée au fil des ans, après sa mort en 1980. On ne sait pas encore s'ils ont tous été publiés mais si vous vous sentez courageux vous pouvez trouver une copie des transcriptions ici. De plus, la complexité de sa pensée et de son expression rendait difficile une traduction précise, et il n'est pas exagéré de dire que plusieurs des écoles les plus impénétrables de la théorie sociale américaine moderne ont leurs origines dans des malentendus sur ce que disait Lacan. (Un résultat piquant pour un psychanalyste.) Les résultats de son influence sont donc quelque peu équivoques.
Néanmoins, permettez-moi de trancher et de saisir quelques-unes des idées les plus intéressantes et les plus utiles de Lacan, et de voir où elles nous mènent. Chacune a de l'intérêt mais aucune, comme vous vous en doutez, n'est tout à fait originale. Dans chaque cas, je les décrirai brièvement, puis j'expliquerai comment je pense qu'elles peuvent être utiles pour comprendre à la fois comment les crises politiques sont gérées et comment elles sont interprétées et écrites. Si vous souhaitez les approfondir, il existe plusieurs bons guides de la pensée de Lacan en anglais, dont le plus récent et le plus sans jargon est celui de Todd McGowan, qui possède également une chaîne YouTube informative.
La première est l'idée de l'Ordre Symbolique, qui est la structure qui sous-tend toutes nos actions et leur donne une signification. C'est ainsi que nous comprenons la réalité et comment, à travers le langage, nous communiquons avec les autres. L'Ordre Symbolique n'est pas optionnel, et nous y sommes toujours soumis. Maintenant, cela ressemble à du Structuralisme, et en effet les étudiants de Lacan ont trouvé des précédents clairs chez Lévi-Strauss et Saussure, mais Lacan s'efforce de ne pas présenter le Sujet comme une victime impuissante de l'Ordre (comme le pourraient Marcuse et Foucault) mais comme un individu actif et subjectif. L'Ordre Subjectif énonce une série de concepts (certains les ont appelés "fictions") qui permettent au Sujet de s'orienter, mais il n'y a pas de structure globale visible, et en effet il n'agit qu'indirectement. Ces concepts ne sont pas nécessairement cohérents entre eux et ils ne s'imposent pas à nous. Nous acceptons ceux qui correspondent le mieux aux besoins de notre psychisme. Il n'y a, bien sûr, aucune raison pour que les concepts reflètent fidèlement l'ordre réel des choses, ce qui est un point important sur lequel nous reviendrons dans un instant.
Le langage est ici primordial, et Lacan hérite de Saussure l'idée qu'il n'y a pas de lien entre les mots eux-mêmes (signifiants) et les objets auxquels ils sont censés se référer (le signifié). Le langage ne renvoie donc pas à la réalité des objets. Dans la mesure où il y a une relation, elle est négative : ainsi, dit Saussure, le signifiant "enfant" est simplement compris comme signifiant conventionnellement « pas un adulte«. Mais alors que pour Saussure le signifié est le plus important, pour Lacan en tant que psychanalyste, le signifiant-dans ce cas les mots qui sont réellement utilisés-est ce qui compte vraiment, car le signifiant représente le fonctionnement de l'inconscient : comment, si vous voulez, l'inconscient choisit de représenter le monde matériel aux autres et à lui-même. Un exemple pertinent évident est le signifiant « agression«, dont l'utilisation presque infiniment variable nous en dit long sur la personne qui l'utilise et sur sa façon de voir le monde. Dans ma jeunesse, un certain type de personne demandait « comment pouvons-nous arrêter l'agression américaine au Vietnam ? » communiquant ainsi sous forme résumée, quoiqu'inconsciemment, toute une philosophie politique. De nos jours, si quelqu'un vous dit que la guerre en Ukraine est le résultat d'une « agression de l'OTAN » (et qu'il ne travaille pas pour le gouvernement russe), cela communique de la même manière, quoiqu'inconsciemment, toute une vision du monde, et vous permet de prévoir leurs opinions sur toute une série d'autres questions.
De plus, toutes les parties de l'Ordre symbolique n'ont pas le même statut : certains signifiants ont un statut plus élevé que d'autres. Peu de mouvements politiques adoptent volontairement le signifiant « extrême«, par exemple : il est considéré comme un signifiant de statut inférieur, quelles que soient les politiques réelles que le mouvement peut adopter et la manière dont il aurait été décrit dans le passé. De même, les signifiants entrent et sortent de la mode : "patriotique" est passé de mon vivant d'un signifiant largement positif à un signifiant principalement négatif, comme dicté par de mystérieuses règles d'interprétation. Il est notoire que les groupements politiques violents font tout ce qu'ils peuvent pour éviter le signifiant "criminel", bien que leurs activités le soient indéniablement selon les lois de leur pays. L'IRA était prête à faire mourir de faim certains de ses hommes afin d'essayer de changer le signifiant en « prisonnier politique«. Dans ces cas, bien sûr, la réalité, le signifié, n'a pas du tout changé. Et les effets peuvent être assez profonds. Il y a cinquante ou soixante ans, les jeunes hommes avaient tendance à attirer principalement des signifiants idéalisés tels que "aventureux", "autonome", "mature" et "fiable", auxquels ils étaient encouragés à aspirer. De nos jours, les jeunes hommes sont massivement signifiés comme « violents » et « sexuellement agressifs » et, à la surprise générale, ils le sont de plus en plus. On récolte ce qu'on sème.
Bien que Lacan n'ait pas discuté de l'utilisation politique des signifiants, certains de ceux influencés par les traductions anglaises de son travail l'ont fait. Les féministes ont souligné qu'un certain nombre de professions (pompier, laitier) utilisaient le suffixe « homme » et, confondant les mots allemands originaux Homme, un mot neutre signifiant « quelqu'un » ou « une personne » et Mann un mot masculin signifiant, eh bien, « homme«, a affirmé que l'utilisation d'un mot différent encouragerait les femmes à entreprendre de telles activités. Dans une certaine mesure, cela a été mis en œuvre : "l'homme poubelle" de ma jeunesse est maintenant un "agent d'élimination des ordures", bien que je n'aie pas de chiffres sur la participation des femmes dans ce domaine. Mais plus important encore, il y a une tendance politique moderne à changer le signifiant en quelque chose qui déforme activement ou déguise ce qu'est réellement le signifié. Ainsi, « sans logement » donne l'impression qu'une personne sans abri est temporairement à court de maison, « sans papiers » suggère qu'un immigrant illégal n'a tout simplement pas encore reçu de documents par erreur, "demandeur d'emploi" déguise le fait que la personne concernée vient d'être licenciée et reporte sur eux la responsabilité de trouver un emploi. Plus sérieusement, peut-être, signifier Gaza comme étant une "guerre" entraîne toute une série d'hypothèses et de normes, dont beaucoup sont naturellement inconscientes, qui ont pour effet pratique de changer ce que nous pensons des événements sur le terrain ; le signifié.
Le deuxième concept dont je veux discuter est le Grand Autre, traduit de manière quelque peu inélégante en anglais par The Big Other. Par-là, Lacan n'entend pas des autorités formelles comme le gouvernement, mais plutôt une sorte d'autorité sociale dont nous suivons les diktats et qui structure nos vies, et nous permet en effet de donner un sens au monde et de communiquer les uns avec les autres (un peu). Cependant, et toujours en contradiction avec les structuralistes, Lacan est très clair sur le fait que le Grand Autre n'a pas d'existence objective. C'est une construction humaine collective, composée de règles et de coutumes que nous créons pour nous-mêmes (si cela semble improbable, considérez simplement une cour de récréation scolaire.) Nous réifions le Grand Autre, nous cherchons son approbation et sa reconnaissance et nous lui prenons notre identité symbolique. Mais parce qu'il n'existe pas réellement, nous ne pouvons jamais le satisfaire, et parce qu'il s'agit d'une construction collective de notre conception, il ne peut pas nous fournir de conseils utiles.
Le Grand Autre apparaît sous de nombreuses formes, certaines d'entre elles en compétition. Dans sa forme originale, il s'agit bien sûr de l'Autorité parentale : pas nos parents humains réels et imparfaits, mais le concept que nous créons autour d'eux. À l'époque où la parentalité était plus stricte qu'aujourd'hui, l'adolescence était le moment de la remise en question et de la libération de ce Grand Autre, et de son remplacement par des règles sociales plus larges. De nos jours, dans un monde d'adolescence permanente, beaucoup de nos dirigeants et experts restent en conflit avec leur Grand Autre parental : Poutine, par exemple, est pour beaucoup d'entre eux la figure du parent sévère qui, contrairement au leur, ne les laissera pas avoir tout ce qu'ils veulent, comme l'Ukraine. Et les illusions que nous avons sur nos parents quand nous sommes petits - omniscients, omnipotents avec des rituels mystérieux que nous ne comprenons pas - se transfèrent au fur et à mesure que nous grandissons dans des abstractions imaginaires comme le Patriarcat, ou l'État Profond, ou même projeté sur des Agences de renseignement réelles, dont toutes les connaissances et tous les pouvoirs sont également illimités et dont le fonctionnement est à jamais mystérieux.
Mais, dit Lacan, se libérer du Grand Autre parental, si nous pouvons le faire, signifie seulement que nous cherchons d'autres Grands Autres. Nous recherchons la validation, le statut et la reconnaissance d'autres constructions collectives imaginaires. Certaines sont évidentes - le système juridique, les codes sociaux dominants, la religion organisée - mais d'autres sont plus indirectes et plus intéressantes. Il y a un Grand Autre politique dominant, où le prix d'admission et de reconnaissance est d'avoir les bonnes opinions. On le voit en ce moment avec l'Ukraine et Gaza. Mais il y en a aussi de Grands dissidents ou transgressifs, où les individus recherchent la reconnaissance et le statut précisément parce qu'ils n'ont pas les bonnes opinions ou le Bon comportement. À dix minutes en voiture de l'endroit où j'écris ces lignes se trouvent des communautés où le statut et la reconnaissance découlent de la désobéissance à la loi, de l'utilisation de la violence et de gagner beaucoup d'argent rapidement, et où le Grand Autre est la criminalité organisée liée à la drogue.
Il n'est pas impossible d'échapper aux effets du Grand Autre (en effet, Lacan y voyait l'un des objectifs de la psychanalyse) mais c'est très difficile. Les véritables individualistes sont extrêmement rares, c'est pourquoi, par exemple, chaque fois que je suis un lien vers un blog qui "expose les mensonges" sur l'Ukraine ou Gaza et qui est fièrement indépendant et farouchement non conformiste, je trouve qu'il dit exactement la même chose que tous les autres blogs fièrement indépendants et farouchement non conformistes qui exposent les mensonges, etc. À bien des égards, cela n'est pas surprenant. En dehors de notre expérience de vie immédiate, et peut-être de nos connaissances et de notre expérience professionnelles, peu d'entre nous possèdent réellement ce qui est nécessaire pour des jugements véritablement indépendants : tout ce que nous avons, c'est le choix entre les différents Grands Autres. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas ou ne devrions pas avoir d'opinions personnelles, mais si nous commençons à les diffuser et à nous attendre à ce que les autres nous écoutent, nous devons accepter que ce que nous faisons en pratique est de chercher l'approbation et la validation d'un Grand Autre, ou inversement, en étant rejeté et ostracisé, nous cherchons l'approbation d'Un Autre Grand Autre. Il est notoirement vrai qu'il n'y a personne de plus conformiste que l'anticonformiste rigoureux : seul le Grand Autre est différent.
Il est important de comprendre ce que cela signifie et ne signifie pas. L'inconscient n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, ce n'est pas un résidu primitif de violence et de terreur, et les décisions qu'il prend (qui sont la majorité d'entre elles) ne sont pas intrinsèquement pires que les décisions prises par l'esprit conscient. Sans lui, nous ne pourrions pas fonctionner. Mais, comme son nom l'indique, il échappe à notre contrôle conscient et n'a aucune notion du temps : il vit toujours dans le présent. Certaines personnes trouvent cela effrayant et rebutant, et il n'est pas surprenant que nous fassions de grands efforts pour trouver des explications rationnelles et conscientes aux décisions prises par l'inconscient, tout comme à notre tour nous faisons de grands efforts pour trouver des explications rationnelles et conscientes aux décisions des gouvernements et des organisations qui sont évidemment principalement le produit de forces inconscientes.
En réalité, peu de ce qui précède devrait être controversé. Considérez : il y a deux possibilités. Soit tous les jugements, décisions et discours ont tendance à s'appuyer de manière disproportionnée sur l'inconscient et sur des motivations inconscientes, des espoirs et des peurs, soit uniquement, dans le cas de la gestion et de l'écriture de crises politiques, seul l'esprit conscient est impliqué, et tout le monde (ou au moins un hypothétique Grand Autre) sait exactement ce qu'il fait. (Ce son que vous venez d'entendre était Guillaume d'Occam affûtant son rasoir.) La question n'est pas de savoir si cette image de la façon dont les choses fonctionnent est vraie (puisqu'elle l'est évidemment), mais comment nous l'utilisons pour mieux comprendre le monde. J'ai essayé de faire quelques timides propositions dans cet article.
Aurelien
Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.