
Raphael Machado
L'étude de la dimension politique de l'œuvre du philosophe traditionaliste italien Julius Evola se heurte toujours au « mur » représenté par sa phase tardive — celle qui se définit par le célèbre (et peu lu) livre Cavalcare la Tigre (= Chevaucher le Tigre).
L'œuvre en question tire son nom d'une parabole orientale qui raconte la terreur causée par un grand tigre dans une région désertique. La seule solution, que trouve le « héros », le cas échéant, est, au lieu d'affronter directement le tigre, de sauter sur son dos, de l'agripper et de s'y tenir jusqu'à ce que la bête s'épuise. Ce n'est qu'alors qu'il devient possible de donner le « coup de grâce ».
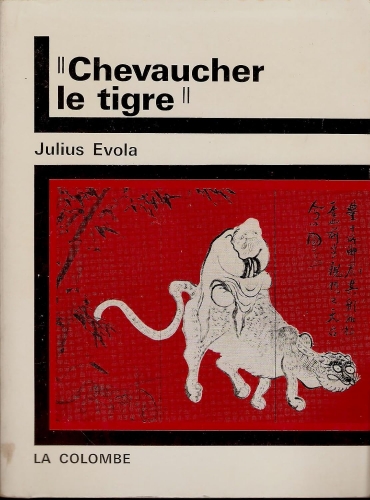
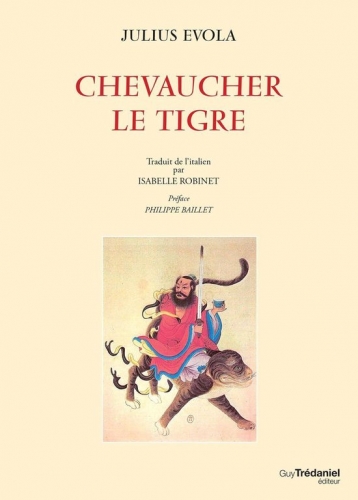
Ce que cela signifie politiquement, pour Evola, fait l'objet d'innombrables interprétations divergentes.
La période tardive d'Evola est habituellement décrite comme une période de «lassitude» face à l'engagement politique — surtout celui de ses «disciples», puisque lui-même n'a eu que quelques années pour tenter d'influencer positivement les régimes fascistes européens des années 30-40.
Cependant, l'Italie des années 50 et du début des années 60 représentait le nadir spirituel de la nation. Elle était occupée militairement par une puissance étrangère, culturellement corrompue par l'invasion de produits de l'industrie culturelle américaine, psychologiquement fracturée par le chaos démocratique, et dans le panorama politique intérieur, Evola voyait que même le nationalisme anti-libéral et anti-communiste s'était rendu conforme à l'ordre hégémonique de manière qui n'était pas simplement superficielle.

En sous-main, de plus, les plus exaltés commençaient à recourir au terrorisme et à la guérilla urbaine comme tactique de déstabilisation de l'ordre libéral-démocratique. Aux yeux d'Evola, une aventure vouée à l'échec.
Dans ce contexte, la posture à adopter par « l'homme différencié » est celle de l'apolitisme (l'apoliteia).
À partir de ce point, cependant, il est possible d'offrir une vision peut-être plus profonde; la question pourrait être la suivante: dans le stade actuel du cycle civilisationnel, tout effort pour inverser ou contenir la déchéance par l'action politique serait voué à l'échec — le cycle étant trop avancé, et la pourriture intérieure du fascisme et son échec inévitable en étant la preuve évidente.
Selon cette lecture, assez répandue, aucune action politique n'est plus utile ou nécessaire jusqu'à la fin du Kali Yuga. Cavalcare la Tigre représente l'attitude de ceux qui, simplement, « vivent parmi les ruines » en attendant la Fin. D'où l'apolitisme. Naturellement, il ne s'agit pas d'une attente passive, mais d'une attente dans laquelle « l'homme différencié » entreprend le chemin de la lutte spirituelle, cherchant à atteindre sa libération — ou, selon la phase philosophique d'Evola, à devenir « l'individu absolu ».

Certains disciples d'Evola ont toutefois compris l'apolitisme non comme un abandon de tout engagement politique extérieur, mais comme une disposition intérieure impliquant un double engagement: 1) ne pas se soumettre aux règles politiques du système hégémonique; 2) ne pas s'impliquer émotionnellement dans tout engagement politique extérieur (d'où l'appel au dialogue entre Krishna et Arjuna dans la Bhagavad Gita, comme modèle d'un ethos de l'« action désintéressée »). Pour l'« homme différencié », il restait, selon cette lecture plus radicale, le chemin de la « milice » et de la « guerre sainte ».
Ce dernier point est resté marginal dans l'école évolienne, la majorité ayant toujours interprété l'apolitisme comme une abandon total de l'engagement politique et une focalisation complète sur la « jihad intérieur », avec un autre courant adoptant une posture « modérée » à l'égard de l'engagement politique.
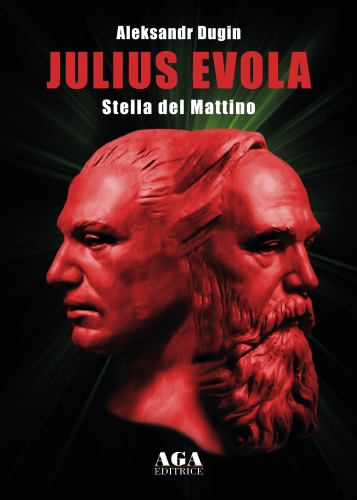
Le « premier Douguine » propose une lecture particulière de cette question.
Plus récemment, Douguine s'est longuement replongé dans la pensée d'Evola et lui a consacré un livre entier — Julius Evola : Stella del Mattino (= Étoile du Matin), publié jusqu'à présent en Italie uniquement. Dans cette œuvre, notre ami russe propose une lecture essentiellement métaphysique et alchimique de la métaphore du Cavalcare la tigre, en se concentrant sur le caractère yang/yin de la métaphore (puisque Douguine fait remonter la maxime jusqu'à la Chine ancienne), où le tigre représente les forces déchaînées du yin, et le chevaucheur, qui est sous-entendu dans la parabole, n'est pas proprement le yang (qui serait, en réalité, affaibli, déchu à l'ère présente), mais le représentant terrestre du yang.
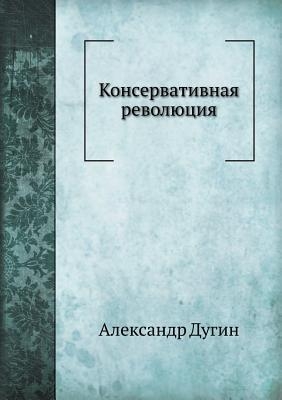
Mais 35 ans auparavant, en 1990, Douguine avait formulé quelques réflexions politiques significatives sur l'ouvrage Cavalcare la Tigre, qui furent peu après publiées dans son livre intitulé Révolution conservatrice (Konservativnaïa Revolioutsia). Le penseur russe le situe spécifiquement dans une sorte d'antipode apparent de l'« impérialiste païen ».
Le terme désigne le sujet hypothétique de l'ouvrage Impérialisme païen, un texte de jeunesse dans lequel Evola propose une critique programmatique du fascisme à partir de la perspective d'une pensée politique « conservatrice révolutionnaire » fondée sur une tradition impériale à la fois romaine et gibeline. Là, Evola esquisse — parfois de façon générale, parfois en détail — sa conception de l'État idéal, sa « Platonopolis ». L'œuvre représente, peut-être, le « degré maximal » de politisation de la Tradition, et c'est dans ce sens que Douguine le pose comme la contrepartie de Cavalcare la Tigre.
Tandis que la posture prônée dans Cavalcare la Tigre ressemble à celle de l'anarque jüngerien qui amorce son « Waldgang » — ou, en d'autres termes, la figure de l'« anarchiste de droite » — 30 ans auparavant, Evola offrait au monde la perspective de l'« impérialiste païen ». Changement d'avis ? Maturité ?
Douguine nie toute chose de ce genre. Au contraire, dans la lecture douguinienne, l'« homme différencié » reste toujours le même, ce qui change est le monde du devenir, constamment affecté par les mouvements cycliques et les chocs entre volontés de pouvoir.
Et dans la mesure où le monde change, l'« homme différencié » aborde le monde de différentes manières, selon la phase dans laquelle il se trouve. En ce sens, l'« impérialiste païen », le « gibelin radical », le « conservateur révolutionnaire » devient « anarchiste » et « se retire dans la forêt » lorsque les conditions deviennent défavorables, et que la lutte politique devient infructueuse. La seule chose que l'« homme différencié » a à offrir au monde dominé par les forces de la Contre-Institution est son « Non ».
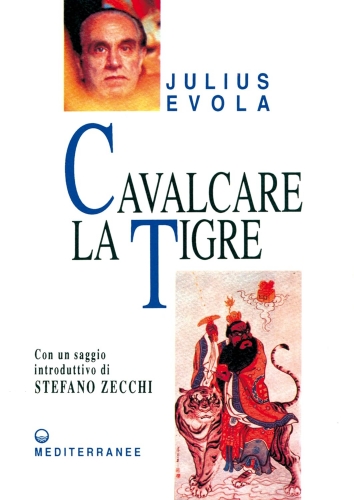
Mais dans la mesure où le monde n'est pas, encore une fois, statique, l'«anarchiste» évolien est toujours prêt à «prendre d'assaut les cieux» lorsque les conditions objectives redeviennent favorables à l'action politique (désintéressée).
En réalité, toute la période de la « jihad intérieur » est aussi une préparation à la conquête extérieure du monde, à la «jihad extérieure», «lorsque les étoiles seront alignées».
La lecture douguinienne de cette question offre la sortie la plus adaptée à l'impasse de la «scolastique évolienne» concernant les possibilités d'action dans les phases finales du Kali Yuga.