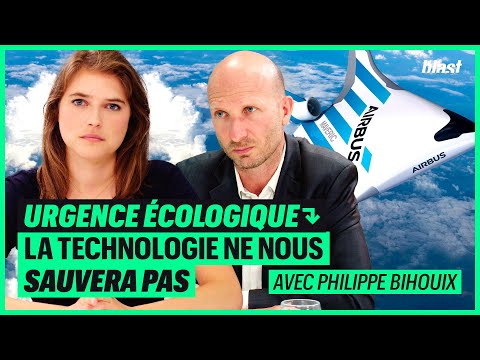À grand renfort de fonds publics, l'État alimente la technologisation de l'agriculture, une stratégie qui va à l'encontre de la nécessaire transition écologique. Pourtant, une autre solution, celle de l'agroécologie, est possible. Décryptage.
« Il fait peu de doute qu'un agriculteur de la seconde moitié du XIXe siècle, voire de la première moitié du XXe siècle serait ébahi en visitant les exploitations laitières actuelles et les nouvelles méthodes d'élevage : il y découvrirait des vaches étendues sur des revêtements de sol en caoutchouc ou sur des matelas à poches d'eau climatisés par une pompe à chaleur, des robots pousse-fourrage connectés à des transpondeurs, des robots à lisier, des salles de traite totalement automatisées », décrit le sociologue Philippe Le Gern dans son article Robots, élevage et techno-capitalisme.
Et c'est à peu près à ça que ressemblent certaines structures agricoles technologiques, surtout des élevages de bovins, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Cette politique technosolutionniste fortement soutenue par l'État continue pourtant d'enfermer l'agriculture dans ses travers d'endettement, alors qu'une transition agroécologique est possible.
Et si on arrêtait le technosolutionnisme de l'agriculture ?
Selon les chiffres 2024 de l'Insee, L'agriculture joue un rôle crucial dans l'économie française. La France est en fait le premier producteur agricole de l'Union européenne, contribuant à environ 18 % de la production agricole totale de l'UE. Le secteur emploie près de 750 000 personnes directement, sans compter les emplois indirects. Par ailleurs, les exportations agricoles et agroalimentaires françaises ont généré environ 62 milliards d'euros en 2019, faisant de ce secteur un pilier essentiel de l'économie du pays.
L'État chouchoute alors la filière agro-industrielle, qui, depuis quelques années, ne compte plus les milliards dépensés pour la soutenir (en imposant des prix bas pour que les intermédiaires puissent marger au maximum, à savoir les supermarchés et industriels de l'agroalimentaire). Dernièrement, l'État a abondé le marché de 2 milliards d'euros à travers le Fonds européen pour l'innovation.
La BPI France à l'heure de l'agritech
Vous avez peut-être entendu parler de la Banque Publique d'Investissement, la BPI France, organisme de financements des entreprises détenu à 50 % par l'État et 50 % par la Caisse des Dépôts ? Elle imagine faire de la France « la championne de l'agritech »dans le but de « nourrir 10 milliards d'individus en 2050 avec des ressources naturelles limitées ».
Au cours des trente dernières années, la France a subventionné une technologisation de l'agriculture, à grands renforts d'appel à projets, concours d'innovations et avec de larges financements. À titre d'exemple, Agricool, qui n'a de cool que le nom, puisque cette startup, qui se concentrait sur « des pratiques durables et respectueuses de l'environnement », voulait cultiver des fraises et des aromatiques dans des containers high-tech grâce à la culture verticale, avec pour devise « produire dans 30m2 ce que l'on produit sur 4000 m2 en culture classique ».
Caratéristique du greenwahsing, cette « licorne verte », entreprise valorisée à plus d'un milliard de dollars, a néanmoins été soutenue par la BPI France via son Fond Large Venture, comme l'affirme le magazine Climax (numéro cinq, p 62).

L'agritech : comment endetter et enterrer encore plus d'agriculteurs ?
Ce qui est proposé par l'Agritech aux agriculteurs à bout de souffle, ce n'est surtout pas d'être payé dignement et de favoriser l'agriculture bio, mais de s'équiper de tout un tas d'outils ultra-technologiques, énergivores et extractivistes, comme les capteurs intelligents, les satellites, robots et autres.
- Information - Soutenir Mr Japanization sur Tipeee
À l'heure où il est nécessaire de réfléchir à une décroissance technologique et la reprises de savoirs paysans, il est contre-productif de soutenir des projets tel que celui de l'entreprise Cyclair qui s'appuie sur des technologies de deep learning pour faciliter le désherbage mécanique de son robot autonome RobiOne ; Ou encore de Telaqua, qui développe un système de gestion de l'irrigation sous forme SaaS basé sur de l'intelligence artificielle.
Engraisser les banques sur le dos des agriculteurs
L'agriculture souffre du capitalisme : toutes ces innovations, même partiellement financées, ont un coût faramineux pour les agriculteurs. Avec un endettement moyen de 204 330 euros par exploitation, soit quatre fois plus qu'en 1980, selon le service de la statistique du ministère de l'Agriculture, et selon l'association L214, un endettement moyen des éleveurs de volailles de 257 100 euros et de 431 400 euros pour les éleveurs de cochons, le problème de l'endettement nuit considérablement aux renouvellements des populations d'agriculteurs et contribue peut-être aux trop nombreux suicides dans cette profession.
« 20 % des agricultrices et agriculteurs en France vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté »
Une émission de France inter sur les agriculteurs affirme qu'environ 20 % des agricultrices et des agriculteurs en France vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et parmi eux, 11 000 exploitants percevraient le RSA dans le système de production actuel.
Au vu de cette précarité, la seule possibilité pour ces agriculteurs de technologiser leurs activités est de souscrire à des crédits bancaires. Ceux qui pourront y accéder seront évidemment ceux qui sont déjà solides économiquement. Pour rentabiliser cette robotisation de l'agriculture, l'émergence de mégastructures sera alors fort probable.
Dans son article Robots, élevage et techno-capitalisme, Philippe le Guern mentionne deux tendances simultanées : « d'une part, la diminution du nombre d'exploitations agricoles, avec plus de la moitié ayant disparu en 20 ans, et d'autre part, l'augmentation de la taille moyenne des exploitations restantes. Tandis que les petites exploitations, représentant 7 % de la surface agricole utilisée, continuent de disparaître progressivement, les grandes exploitations ont renforcé leur présence, possédant désormais une surface moyenne de plus de 100 hectares. »
Quel futur souhaitable ?
Après tout, si beaucoup de métiers sont « facilités » par la technologie, pourquoi pas celui des agriculteurs, métier pénible et difficile, comme le montre si bien le film La Ferme des Bertrand, de Gilles Perret ? Mais comment éviter l'endettement massif et une autre dépendance supplémentaire ?
En effet, les robots et autres outils technologiques dédiés à l'agriculture sont des technologies dites « fermées » par les firmes qui en sont à l'origine, ce qui renforce le lien de dépendance des agriculteurs aux constructeurs. Il existe cependant des structures comme L'Atelier Paysan, une coopérative d'autoconstruction qui accompagne les agriculteurs dans la conception et la production de leurs outillages.
L'agroécologie peut nourrir toute l'humanité
L'agroécologie pourrait être une alternative souhaitable à l'approche technosolutionniste de l'agriculture, qui met en avant une approche durable et systémique intégrant des pratiques écologiques et sociales pour améliorer la résilience et la biodiversité des systèmes agricoles.
On peut lire dans un article de Vert le média, intitulé L'agroécologie peut-elle nourrir toute l'humanité ?, que certes, les méthodes agroécologiques n'ont pas l'objectif du conventionnel - à savoir la maximisation du rendement à tout prix - et ces méthodes moins productivistes peuvent induire jusqu'à 25 % de pertes de rendement par rapport aux méthodes conventionnelles. Pourtant, il est tout à fait possible de nourrir 9,5 milliards d'humains de cette manière, sans avoir recours à la hightech et en respectant, qui plus est, la biodiversité.
Cependant, il faudra changer de modèle agricole et de consommation et, sans surprise, limiter la consommation d'animaux et de leur lait, car les animaux d'élevage consomment eux-mêmes environ le quart de l'ensemble des végétaux produits sur les terres cultivables de la planète. Cela pourrait libérer de l'espace pour la consommation humaine tout en évitant à 3,2 millions d'animaux issus d'élevages d'être abattus en France pour l'alimentation humaine, selon l'association L214.
Limiter, voire arrêter le gaspillage est aussi une solution, évitant ainsi, par exemple, à 8,8 millions de tonnes de déchets alimentaires, soit 129 kg par personne d'être jetés à la poubelle chaque année en France.
- Maureen Damman
Photo de couverture : Unsplash
- Information -