« Approfondir l'étude de la répression équivaut à se demander de nouveau comment l'oligarchie s'est préparée et a préparé ses partisans pour le terrible massacre auquel ils se sont livrés avec une totale détermination à partir du 18 juillet 1936 », affirme l'historien Francisco Espinosa Maestre dans la dernière partie de La justicia de Queipo (2000). Dans son livre, il abordait la violence et la terreur fascistes dans les provinces de Séville, Huelva, Cadix, Cordoue et Badajoz ; l'auteur a principalement travaillé sur les documents des anciennes Archives du Tribunal de Guerre de la IIe Région Militaire, ce qui a représenté une «véritable descente aux enfers ».
Francisco Espinosa Maestre (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954) est l'auteur (en solitaire) de plus d'une dizaine de livres sur la Deuxième République, la guerre de 1936 et la répression franquiste, entre autres La Primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (Crítica, 2007) [Le Printemps du Front Populaire. Les paysans de Badajoz et l'origine de la guerre civile] et Luchas de historias, luchas de memorias. España, 2002-2015 (Aconcagua, 2015) [Luttes d'histoires, luttes de mémoires. Espagne, 2002-2015]. Il a également été, entre 2005 et 2010, directeur scientifique du projet Todos los Nombres [Tous les Noms], base de données lancée à l'initiative du syndicat CGT et de l'association Nuestra Memoria [Notre Mémoire] qui informe sur les victimes des représailles franquistes en Andalousie, Estrémadure et Afrique du Nord. L'historien soutient que la répression franquiste a été blanchie dès l'origine, en juillet 1936. Comment ont avancé, dans ce contexte, les recherches historiographiques ? « Très lentement, car il y a toujours eu, de la part du pouvoir, une attitude opposée à ces investigations ; elles se sont faites à contre-courant », souligne Espinosa Maestre dans l'interview réalisée par courrier électronique JU1.
L'Université d'Alicante a effacé - de certains articles publiés sur son site ouèbe - le nom du greffier qui avait participé au Conseil de Guerre qui a condamné à mort le poète Miguel Hernández, en 1940 ; l'Université répondait ainsi à la demande d'un descendant du militaire agissant en tant que greffier, qui se réclamait de la législation sur la protection de données. Qu'est-ce que cette décision de l'Université [qui a par la suite rectifié et annulé cette suppression] a mis en évidence ?
Elle met en évidence le fait que toutes les avancées réalisées à grand-peine depuis la transition dans un domaine aussi obscur que celui de la répression peuvent disparaître d'un moment à l'autre. On frôle le grand guignol quand le fils d'un individu qui a fait partie de l'appareil répressif judiciaire militaire fasciste demande à une Université qu'on occulte dans certains articles de son site le nom de son père, et quand quelqu'un, dans cette Université, décide d'obtempérer. Comme il lui déplaît que le nom de son père apparaisse en rapport avec un conseil de guerre dont il avait été le greffier, il veut effacer le passé en le retouchant. Mais la farce ne finit pas là, car, par la suite, c'est l'Université d'Alicante elle-même qui décide de valider cette décision [il semble qu'ils ont ultérieurement fait marche arrière]. Le fait est grave en soi et il dessine de sombres perspectives, car il ouvre la possibilité pour d'autres de suivre cet exemple. Imaginons un instant le cas opposé : que des descendants de personnes apparaissant dans La Causa General* demandent au Ministère de la Culture d'occulter leurs noms sur Internet...

Nous compensons la mémoire historique avec l'Alzheimer juridique
Quels types de discours a-t-on utilisés pour blanchir la répression franquiste et la dictature ? (tu as cité, entre autres, dans des livres et des articles, celui d'une soi-disant « troisième Espagne » située entre ce qu'on appelle les deux camps, ou des affirmations comme « tous les morts sont pareils »).
La répression franquiste a été blanchie dès l'origine. La première chose qu'on a faite, ç'a été de la justifier à travers deux procédés : inventer une révolution communiste en marche que le soulèvement avait prévenue, et propager sans cesse l'idée que, si les Rouges ne mirent pas en œuvre leurs projets criminels, c'est parce qu'ils n'en eurent pas le temps. On suppléa à l'absence d'une terreur rouge spécifique justifiant les massacres qui eurent lieu partout par des histoires macabres que la presse favorable au putsch fit circuler conformément aux instructions des services de propagande. La plupart étaient fausses, mais elles remplirent la fonction pour laquelle elles avaient été créées : assumer dans chaque endroit une terreur qui effrayait les secteurs les moins radicaux de la droite elle-même et que personne n'aurait pu imaginer au préalable.
Et que s'est-il passé ensuite, tout au long de la dictature franquiste ?
Les résultats de cette aberration juridique appelée la Causa General restèrent en vigueur (c'était un processus judiciaire réalisé après la guerre, destiné à justifier le putsch et la répression). Mais les résultats furent si décevants qu'ils ne furent jamais publiés intégralement, mais seulement de façon sélective, dans un livre bien connu qui connut des dizaines d'éditions. Les recherches réalisées hors d'Espagne depuis les années 60 ouvrirent d'autres perspectives qui affectèrent pleinement la question de la répression. On percevait de plus en plus clairement que les proportions du massacre perpétré par les putschistes dépassaient largement les chiffres de la propagande franquiste. C'est dans ce contexte que prend place la tentative du général Salas Larrazábal de reconnaître, dans son Víctimas de guerra [Victimes de guerre], un nombre supérieur de victimes de la répression franquiste, sans renoncer à affirmer que les Rouges avaient assassiné davantage.
Tout cela vola en éclats, lorsque les investigations réalisées depuis la fin des années 70 démontrèrent, province par province, la réalité de la répression dans toute sa dimension, tant dans les zones contrôlées par les insurgés que dans celles qui étaient restées au pouvoir de la République. Tout cela s'est fait très lentement, car il y a toujours eu, de la part du pouvoir, une attitude contraire à ces recherches. Elles se sont faites à contre-courant. À un certain moment, ce processus a rejoint le mouvement en faveur de la mémoire, qui a connu son apogée dans la dernière décennie, et qui a signifié une catharsis pour la société espagnole, qui voyait enfin sous ses yeux les fosses communes et les exhumations. Là aussi, la réaction s'est manifestée, d'abord à travers les révisionnistes encouragés par le Parti Populaire et la droite médiatique depuis la fin des années 90, et, plus tard, depuis certains départements universitaires. On peut affirmer, grossièrement, que l'Université, peu impliquée dans cette histoire et fidèle à son conservatisme traditionnel, préférait d'autres thématiques moins délicates. On a assisté en même temps à la renaissance du mythe de la Troisième Espagne, revivifié en l'occurrence par toute une série de romanciers en général en rapport avec le groupe PRISA, et dont la mission a consisté à renvoyer dos à dos les deux camps, les Rouges et les Bleus,* préservant une soi-disant Espagne idéale et vertueuse qui se situerait au-dessus des deux partis.
« Cela fait trente ans que nous racontons, province par province, et village par village, ce qui s'est passé en Espagne à partir du 17 juillet [1936] et il y a des gens qui ne veulent rien savoir. Tout ce qui a trait à la répression fasciste les gêne et les irrite », as-tu écrit en 2012. De qui veux-tu parler ?
Je veux parler de la droite espagnole, qui n'a pas rompu avec le fascisme et qui se refuse à admettre le caractère criminel de ce régime, et aussi aux secteurs qui ne veulent rien voir au-delà de la Constitution de 1978. Ces deux catégories assument le modèle de la transition. Mais ce qui, chez les uns, fut une condition pour accepter l'évolution d'un système à un autre sans qu'aucun des leurs en soit affecté, est chez les autres une condition imposée et assumée qu'on pourrait résumer ainsi : vous aurez accès au pouvoir, mais le passé récent n'existera pas pour vous. Autrement dit, amnistie et pacte d'oubli. De là le grand trou noir qui existe entre 1931 et 1975. Le PP n'a aucun problème pour assumer le franquisme, cette époque d'extraordinaire tranquillité, selon les termes d'un de ses dirigeants. De son côté, le PSOE vit dans cette contradiction : il s'agit d'un parti qui, au cours de sa longue étape au pouvoir (1982-1996), a décidé de ne pas regarder en arrière (Felipe González dixit) et dont la date de référence est également 1978, mais, en même temps, il n'hésite pas à se vanter de ses 140 années d'histoire, comme si ce qui est sorti [du Congrès] de Suresnes (1974) et qu'on connaît depuis, avait quelque chose à voir avec le PSOE antérieur à la dictature.

L'immaculée transition, ou la grande ruée à la mangeoire : "Espagnols, Franco est mort". Franco : "Ne vpus inquiétez pas : tout est bien ficelé". Felipe Gonzalez : "Nous sommes une alternative de pouvoir"
Que penses-tu de la caractérisation du franquisme en tant que régime ou dictature « fascistisée », dans le sens où - en dehors du parti phalangiste - la droite espagnole et les élites ont seulement incorporé quelques éléments de fascisme ? Peut-on considérer le franquisme comme une dictature « fasciste », sans plus de nuances, ou réserverais-tu seulement cette appellation à sa première étape ?
Malgré le débat déjà ancien sur le type de régime imposé par les putschistes en Espagne et les réticences persistantes à inclure le franquisme dans les fascismes, je crois que le système sorti du coup d'État militaire, qui s'est implanté au moyen de la terreur dans plus de la moitié du pays en quelques semaines ou mois et qui s'est étendu au reste du pays au moyen d'une longue guerre, fut de caractère fasciste tant qu'il put l'être, c'est-à-dire jusqu'à ce que les développements de la Guerre Mondiale le laissent orphelin, privé des pays qui lui avaient apporté de l'aide depuis le début : l'Italie et l'Allemagne. C'est sous ce signe qu'il a mené à bien la mission pour laquelle il a été créé ; par la suite, il a cherché de nouveaux parrains et évolué à chaque moment au mieux de ses intérêts. Le cas espagnol est différent des cas italien et allemand sur un point essentiel : ici, il n'a pas bénéficié à l'origine du soutien social qu'il avait trouvé dans ces pays. Malgré cela, sans arriver à la perfection du modèle original italien, le franquisme s'est situé de ce côté.
Et si nous considérons ce que les fascistes et les nazis ont fait dans leurs propres pays à l'égard de leurs concitoyens, à l'exception de l'holocauste, le fascisme espagnol, militariste, agraire et catholique, a été l'un des plus avancés dans son instauration au moyen de la violence et de la terreur. La tradition démocratique et parlementaire espagnole était pauvre et faible. On oublie que la dictature franquiste s'est adaptée progressivement à ce qui servait ses intérêts à tout moment, toujours avec le clair objectif de perpétuer les privilèges des secteurs qui l'avaient mise en place. Le fascisme en Espagne est apparu à la suite du putsch militaire, a connu son apogée pendant les années de la IIe Guerre Mondiale, et est devenu une dictature militaire brutale après l'effondrement du nazi-fascisme, au cours d'un long processus qui va jusqu'au milieu des années 50, avec la fin de la guérilla de la Résistance.
Ce qui, en revanche, a existé déjà depuis cette dictature, c'est la ferme intention de sortir le franquisme du monde des fascismes de la période de l'entre-deux guerres, tâche dans laquelle a joué un rôle clé le sociologue Juan José Linz avec sa théorie des régimes totalitaires et autoritaires, parmi lesquels il a rangé l'Espagne avec l'agrément de la droite espagnole et de ceux qui admettent tout au plus l'existence d'un régime fascistisé.
Dans Guerra y represión en el Sur de Espaňa (Université de Valence, 2012) [Guerre et
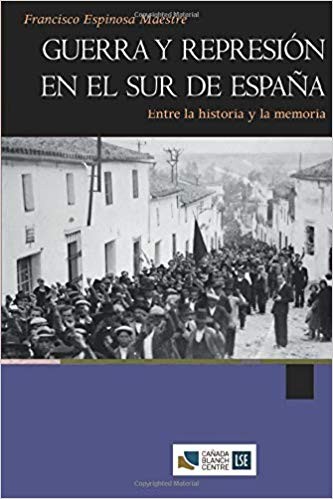 répression dans le Sud de l'Espagne], tu affirmes : « Les insurgés sont descendus dans la rue à 9 heures de l'après-midi le samedi 18 dans des villes comme Séville, Cadix et Cordoue au milieu d'un déploiement de forces sans précédent. Rues et places se sont trouvées couvertes de cadavres qui sont restés à la vue de tous le plus longtemps possible afin que tous sachent à quoi s'en tenir ». Cela signifie-t-il qu'il y avait, de la part des putschistes, un plan (prémédité) d'extermination ?
répression dans le Sud de l'Espagne], tu affirmes : « Les insurgés sont descendus dans la rue à 9 heures de l'après-midi le samedi 18 dans des villes comme Séville, Cadix et Cordoue au milieu d'un déploiement de forces sans précédent. Rues et places se sont trouvées couvertes de cadavres qui sont restés à la vue de tous le plus longtemps possible afin que tous sachent à quoi s'en tenir ». Cela signifie-t-il qu'il y avait, de la part des putschistes, un plan (prémédité) d'extermination ?
Les insurgés savaient déjà d'avance qu'ils allaient rencontrer une forte résistance. C'était déjà prévu dans les instructions de Mola. Cinq mois après les élections qui avaient donné le pouvoir au Front Populaire, ils étaient conscients que la majorité sociale les repousserait, surtout dans les zones agraires où prédominait la grande propriété, et où les syndicats de gauche étaient prépondérants. Seules la violence et la terreur garantiraient la maîtrise d'un territoire avant le passage à un autre. La terreur a été consubstantielle au putsch. Les premiers crimes se produisent le 17 juillet même en Afrique du Nord, siège des troupes de choc de l'Armée et élément clé du soulèvement.
Le 19, il y a déjà des légionnaires et des soldats de l'armée régulière à Cadix et à Algésiras, ils continueront à arriver jusqu'au grand transbordement du 5 août. Ensuite, ce seront des avions allemands et italiens qui transporteront durant quelques mois des milliers d'hommes. Le genre de guerre auquel étaient habituées ces forces est en rapport avec leur origine coloniale, sauf que, cette fois, au lieu d'affronter les tribus du Rif, ce qu'ils trouvaient en face d'eux, c'étaient les habitants des villages et des quartiers des villes espagnoles. Le schéma habituel, c'était une razzia initiale avec droit de pillage, des arrestations suivant des listes déjà élaborées, élimination d'habitants du lieu au cours d'actes publics à valeur d'exemple, assaut contre des maisons et locaux fermés, et partage du butin. Ce schéma continua à s'appliquer depuis le départ d'Afrique jusqu'au coup d'arrêt devant Madrid le 7 novembre 1936, avec pour résultat des milliers de victimes éliminées sans autre forme de procès que le ordeno y mando [« mandons et commandons »].
-Être juif ?...
-Ou être républicain ?
Peut-on appliquer à la répression franquiste les termes d'« holocauste », « génocide », ou « crimes contre l'humanité » ? Peut-on mettre Franco sur le même plan que des dictateurs comme Pinochet, Videla ou Ríos Montt ?
Je crois qu'on peut parler de génocide pour raisons politiques. De même que de disparus et de crimes contre l'humanité. Franco, son putsch et sa dictature ont constitué sans aucun doute une référence pour les dictateurs du Cône Sud, qui l'admiraient. Le cas espagnol leur offrait un modèle à suivre : coup d'État militaire suivi de l'assassinat de milliers de personnes, une longue dictature au service des intérêts de l'oligarchie et, quand cela s'avéra utile, retour à la démocratie sans aucun préjudice pour les agents du système antérieur. Le mot holocauste, lui, est si associé à la disparition des juifs européens que je ne le considère pas adéquat pour le cas espagnol ; je crois qu'on ne peut les comparer ni qualitativement ni quantitativement.
En 2010, sortait le livre Violencia roja y azul. Espaňa, 1936-1950 [Violence rouge et bleue. Espagne, 1936-1950] dont tu étais le coordinateur. Quelles différences y eut-il entre les deux violences ? Estimes-tu qu'elles étaient comparables ?
À la différence des crimes qui eurent lieu en zone franquiste, nous possédons une abondante information sur ceux qui se sont passés en territoire sous contrôle de la République. Il suffit de signaler les 1500 dossiers de la Causa General conservés dans les Archives Historiques Nationales, dont une bonne part est consultable par Internet depuis déjà des années. Dans le livre que tu mentionnes, José Luis Ledesma a établi que les victimes de la terreur rouge s'élèvent à un peu moins de 50 000 personnes. Eh ! bien, après quarante ans de recherches, nous ne pouvons pas encore chiffrer les victimes causées par la terreur bleue. Ce n'est bien sûr pas un hasard : c'est dû, d'un côté, à la ferme volonté du régime du 18 juillet d'occulter le massacre fondateur et, de l'autre, à la politique d'oubli des gouvernements qui ont suivi la transition. Actuellement, 40 ans après celle-ci, et 80 ans après le coup d'État militaire, le chiffre atteint 136 000 victimes, mais ce chiffre est destiné à augmenter considérablement, le jour où nous connaîtrons la réalité de la répression.
Y a-t-il d'autres différences en ce qui concerne la violence, outre les différences quantitatives ?
On ne peut pas éluder le fait que ce sont les putschistes qui ont commencé l'agression, que c'est eux qui disposaient réellement d'un plan d'extermination. À quelques exceptions près, la réaction initiale des comités dans les villages, conformément aux ordres des Gouvernements de Province [équivalent des préfectures], fut d'arrêter les gens de droite qui pouvaient représenter un danger. C'est ce que racontaient et qu'avaient vécu les réfugiés qui quittaient leurs foyers qui mit en péril la vie de milliers de gens de droite détenus dans des zones encore non-occupées. Dans les villes, tout fut différent : le putsch avait détruit les structures de pouvoir et, pendant plusieurs mois, les milices agirent selon leur bon plaisir, assassinant des milliers de personnes dans des villes comme Madrid, Barcelone, Malaga, etc. Malgré cela, les événements ne renvoient pas à l'image iconique du «Duel au gourdin » de Goya, mais à une terrible agression à laquelle on répond de façon assez anarchique. En tout état de cause, les responsables de toute la chaîne de violence sont ceux qui l'ont initiée.
Pourquoi la période de la répression analysée dans le livre cité ne couvre-t-elle pas en premier lieu la guerre civile (1936-1939), puis, d'un autre côté, sa continuation pendant l'après-guerre, au lieu de commencer en 1936 et de se prolonger jusqu'en 1950 ?
Parce qu'une telle division n'a pas existé. Je n'ai jamais oublié ce qu'écrivit dans un rapport un haut responsable de la Garde Civile à la fin de la guerre : il exposait la situation et terminait en affirmant que, bien que la guerre fût terminée, la campagne continuait. Pour les putschistes, la guerre ne fut qu'une parenthèse (novembre 1936-avril 1939) dans le cadre d'un cycle plus large (juillet 1936- milieu des années 50). En ce qui concerne le dispositif répressif, on sait que le processus a connu deux phases, l'une qui va de juillet 1936 à février 1937, où on assassinait au moyen de proclamations militaires, et l'autre de mars 1937 au milieu de 1944, où l'on donna à la répression une apparence de légalité au moyen de la farce des conseils de guerre expéditifs [sumarísimos] d'urgence. C'est-à-dire que le cycle de la terreur va de 1936 à 1944, ce qui coïncide avec l'effondrement des fascismes, même s'il faut dire que ces huit longues années furent suivies de tout autant d'autres années, le temps qu'il fallut pour arriver à écraser totalement la résistance antifranquiste.
Le cycle répressif se prolongea donc sur deux décennies. Au milieu des années 50, interviennent une série de nouveaux éléments qui permettent de parler d'un changement. Il suffira de mentionner le début du processus migratoire et la fin de la période autarcique.
Qu'est-ce que les archives de la terreur, et ce que tu as, en certaines occasions, appelé « les véritables sources sur la répression » ? Sont-elles actuellement accessibles aux chercheurs ou sont-elles classifiées en tant que « secrètes » ?
Le concept d'« archives de la terreur » renvoie au Paraguay et aux documents trouvés et rendus publics en 1992 par Martín Almada, le juge José Agustín Fernández et plusieurs journalistes, concernant la dictature d'Alfredo Stroessner et l'Opération Condor. Le bâtiment où on les a trouvés est aujourd'hui le Centre de Documentation des Droits de l'Homme. Contrairement au cas du Paraguay, nos « archives de la terreur » sont toujours secrètes. Elles sont si secrètes que nous ne savons même pas si elles existent encore ou si elles ont été détruites. Je veux parler essentiellement de la documentation produite sur la répression par l'Armée, la Garde Civile et les Délégations d'Ordre Public (devenues ensuite Commissariats Provinciaux). Nous savons qu'il a existé des fichiers détaillés parce que c'est d'eux que proviennent les données qu'on utilisait dans toute espèce de documents, depuis des certificats jusqu'à des rapports.
Le journaliste Carlos Hernández de Miguel a écrit, en avril 2018, un article sur eldiario.es intitulé « Documents secrets, détruits ou entre les mains de franquistes : la bataille des chercheurs pour la mémoire historique ». Le vol et la destruction de documents, rapports, papiers et fichiers ont-ils été habituels ? Pendant la dictature et pendant la période démocratique ?
Pendant la dictature, très peu de gens avaient accès aux archives militaires : disons, seulement des militaires et des personnes idéologiquement sûres, du type Ricardo de la Cierva. Comme l'a dit l'historien français Charles Morazé : « Toute preuve matérielle d'une décision a d'autant plus de chances d'être soustraite des archives que sa signification politique est importante ». Et en Espagne, on a eu beaucoup de temps pour faire disparaître ces preuves. J'ai l'habitude de mentionner le cas de Badajoz. Dans les archives militaires d'Avila, il y a un rapport que Yagüe envoie à Franco, alors à Séville, sur les résultats de l'occupation de la capitale de l'Estrémadure. Il y indique qu'il détaille les pertes, prisonniers, armement récupéré, etc., dans un document joint. Eh bien, ce document n'existe pas. Quelqu'un a dû penser qu'il valait mieux que personne ne le voie.
Mais ce type de faits ne sont pas seulement arrivés pendant la dictature, ils se sont prolongés pendant la transition et même au cours des années 80. C'est ainsi qu'ont disparu des fonds importants des Prisons Provinciales, des Tribunaux de Ière Instance, des archives municipales, etc. Entre négligence, censure et destruction volontaire, c'est une partie importante du patrimoine documentaire qui a disparu. Et ne croyez pas que tout disparaît. Il s'agit d'un curieux processus sélectif. Ainsi, par exemple, dans le cas des archives municipales, la documentation concernant la conscription et les questions religieuses (congrégations et confréries) est miraculeusement préservée.

L'exhumation de Franco, par Eneko
En dernier lieu, que penses-tu de références à des historiens « militants » et « frontpopulistes », qui promeuvent de plus « une vision idéalisée de la République » ? D'où viennent ces termes disqualifiants et quel est leur objectif ?
Ils viennent de secteurs universitaires qui n'ont jamais vu avec plaisir la recherche sur le putsch de juillet 1936 et ses conséquences ni le mouvement de la mémoire historique. L'union entre Histoire et Mémoire est pour eux une aberration, bien qu'ils sachent très bien que celle-ci, utilisée de façon critique, est une ressource de plus pour l'histoire, très importante en outre en cas de dictatures qui s'efforcent de ne pas laisser de traces. Chacun peut comprendre que, des tortures et des viols, comme de multiples petites histoires, il ne reste pas de témoignage écrit. Dans de nombreux villages qu'on venait d'occuper, on organisa des actes publics où on rasa à zéro et obligea à avaler de l'huile de ricin des femmes signalées pour leurs idées ou parce qu'elles étaient simplement parentes de militants de gauche. Quelqu'un connaît-il un document qui informe sur ces faits ? Seuls les témoignages, oraux ou écrits, peuvent nous y donner accès.
Ce sont aussi ces mêmes secteurs qui considèrent que l'insistance dans l'investigation sur le putsch et la répression franquiste induit une idéalisation de la Deuxième République. Ils critiquent la vision iréniste de ces années chez certains. Derrière cette position, se cache d'ordinaire l'idée que la République fut responsable de sa propre fin. On justifie ainsi ce qui est venu après, non pas ouvertement, mais comme une conséquence du processus qui s'est ouvert en 1931. D'où l'insistance à parler de la Deuxième République et de la guerre civile comme si c'était une seule période.
Il y a en outre une autre question de fond. Le modèle de la transition exige une interprétation du passé qui implique la négation de l'expérience républicaine en tant que dernière référence démocratique avant la Constitution de 1978. Disons que ce sont des processus historiques qui s'excluent. Les défenseurs à outrance du modèle de transition qui s'est lentement ouvert après la mort de Franco pensent qu'il faut laisser de côté la République, le putsch et la dictature pour que tout suive son cours, et ceux qui soutiennent qu'il faut prendre en compte ce passé pensent que le processus de transition s'est déroulé dans des conditions qui impliquaient un continuisme compromettant l'avenir, et le refus d'aborder toute une série de questions importantes qui, tôt ou tard, finiraient par émerger. Le problème de fond a été exposé, à sa façon, par le lieutenant-général Sabino Fernández Campos, comte de Latores et secrétaire de la Maison Royale : « Tout le monde doit s'efforcer de taire ce qu'il est nécessaire de taire pour que les choses qui sont bien établies ne changent pas ». La conclusion est claire : le franquisme n'a pas eu lieu en vain et l'Espagne actuelle procède de lui.
NdlT
* F. Espinosa Maestre met nommément en cause le best-eller de 2001, Les Soldats de Salamine, qui, de fait, met en scène deux héros, le fasciste Rafael Sánchez Mazas, et le soldat républicain Miralles. On pourrait ajouter, au cinéma, Ballade triste pour trompette (2011) d'Alex de la Iglesia, dont une image montre une femme, symbolisant l'Espagne, littéralement déchirée entre les deux camps.
NdE
*La Causa general instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España (Cause générale instruite par le ministère public sur la domination rouge en Espagne) fut une des armes de la répression et de la propagande franquistes après la guerre civile. Instaurée en 1940 et en vigueur jusqu'en 1969, ce fut une énorme instruction pour « connaître le sens, l'ampleur et les manifestations les plus marquantes de l'activité criminelle des forces subversives qui, en 1936, ont ouvertement attaqué l'existence et les valeurs essentielles de la patrie, sauvées à l'extrême, et providentiellement, par le mouvement libérateur ». Dirigée par un procureur spécial, elle a accumulé 4 000 caisses de documents sur les « crimes rouges » de 1931 à 1939, aujourd'hui déposés aux Archives historiques nationales à Madrid.
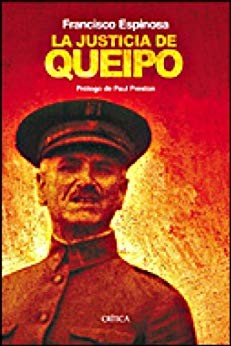
► Todos los libros de Francisco Espinosa Maestre
Courtesy of Tlaxcala
Source: rebelion.org
Publication date of original article: 08/09/2019