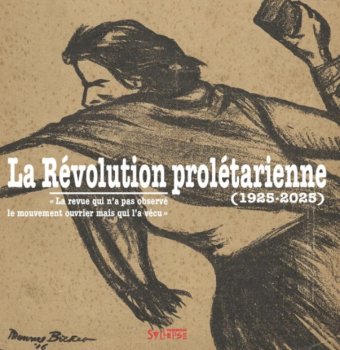
Christian EYSCHEN
À l'occasion des 100 ans de cette revue, les Éditions Syllepse ont publié un très bel ouvrage sur l'Histoire de la revue La Révolution Prolétarienne, très intéressant pour celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire du Mouvement ouvrier. Pierre Monatte, militant ouvrier révolutionnaire plus que respectable et toujours très estimé à travers les temps, disait en 1926 : « La Révolution prolétarienne est la suite de la Vie ouvrière d'avant-guerre, elle est le même effort qui se poursuit avec la plupart de ses fondateurs… Tous ceux qui font un effort pour s'informer honnêtement, pour se former une opinion en connaissance de cause ne perdront pas leur temps en nous lisant. »
La Révolution Prolétarienne (1925-2025)
« La revue qui n'a pas observé le Mouvement ouvrier, mais qui l'a vécu »
Notre camarade Alexandre Hébert citait souvent cette formule : Le refus de parvenir. Elle reprenait le titre d'un roman-témoignage d'Albert-Vincent Jacquet, (« instituteur ; d'abord patriote, puis syndicaliste non conformiste », selon le Maitron) et préfacé par Marc Bloch, pas moins (publié après sa mort en 1956). « Ce dernier était très fier d'être sorti de la classe ouvrière, c'est-à-dire d'en provenir et non de l'avoir quitté. C'est lui qui a le premier parlé du refus de parvenir, c'est-à-dire de passer dans le camp ennemi. » Nous dédions cela à tous les nombreux renégats à travers les âges qui ont été, sont et seront aux antipodes de cette exigence morale.
Refus de renier leurs engagements : si les animateurs de la « RP » doivent arrêter de la publier dans les années noires de Vichy et de l'Occupation, elle reparait dès la Libération et indique : « Après 91 mois de silence ! Le 1er septembre 1939, La Révolution prolétarienne qui existait depuis le 1er janvier 1925 suspendait sa parution. Il était impossible au « Noyau » qui en supportait la charge de se soumettre à la censure. Au reste, ce sabordage prévenait l'interdiction gouvernementale. La révolution prolétarienne, même sous la forme d'un mince souvenir, est demeurée l'ennemie du pouvoir établi, sous le Daladier de la guerre, sous Reynaud, sous Vichy, sous Hitler. La découverte de quelques numéros de notre revue hérétique, au cours d'une perquisition – qu'elle soit menée par la Gestapo ou la police de l'État français – permettait de grossir lourdement le dossier du suspect. Et, après la Libération, la qualité d'ancien rédacteur de La Révolution prolétarienne a orienté certaines proscriptions ou expliqué certaines évictions.
Cependant, La Révolution prolétarienne reparaît aujourd'hui avec la fin du régime de l'autorisation préalable. Elle ne doit rien aux gens en place. Elle reparaît animée, rédigée et administrée par la plupart de ceux qui la fondèrent en 1925 ou qui rejoignirent le Noyau, lors de nos luttes contre la bolchevisation, pour l'unité syndicale, contre la guerre et l'Union sacrée. Sa vie dépend exclusivement de la fidélité de ses amis, des sacrifices de temps et d'argent qu'ils pourront lui consentir.
Elle reparaît et son titre résume tout son programme, toutes ses ambitions. Pas plus qu'en 1925 et en 1939, elle ne sera l'organe d'une chapelle, d'une secte ou d'une tendance. Fidèle à l'esprit de Fernand Pelloutier et du syndicalisme de 1906, fidèle aux traditions de La Vie ouvrière d'avant 1914, elle demeurera une « coopérative intellectuelle », qui ne vend pas d'« articles tout faits, des « comprimés d'idéologies », qui ne diffuse pas de slogans. Elle veut fournir aux travailleurs les moyens de construire leur propre opinion, d'édifier leur propre jugement, de déterminer librement et volontairement les conditions de leur action autonome.
[...] Cependant aujourd'hui encore, notre titre : La Révolution prolétarienne est autre chose qu'une étiquette – il est la plus claire expression de nos espoirs : une Révolution faite par les travailleurs, pour les Travailleurs, une Révolution qui ne soit que la conclusion et le couronnement de l'action ouvrière – ce qui suppose un syndicalisme indépendant, une classe ouvrière éclairée sur sa mission et ses responsabilités, la renaissance de l'Internationalisme ouvrier.
[...] Nous ne demanderons pas aux travailleurs qui nous liront de « croire en nous » et de nous suivre. Nous leur demandons, aujourd'hui comme hier, de « croire en eux » et de suivre les décisions de leur propre conscience. »
Une constante de la « RP » :
La volonté de la réunification syndicale à tout prix :
De la Déclaration des 22 (1931) au PUMSUD (1957)
Ces épisodes sont très connus, même si cela ne déboucha sur rien de réel pour la deuxième tentative, contrairement à la première qui vit la réunification de la CGT en 1936 et sera brisée en 1939, du fait du Pacte germano-soviétique. Mais cela ne retire rien à la symbolique puissante portée alors par ces Appels : la réunification syndicale, qui est dans beaucoup de têtes encore aujourd'hui.
Cela était porté par ce qui allait entrer dans l'Histoire sous le nom de la Déclaration des 22 : « Pour reconstruire l'Unité syndicale. Spontanément, des militants syndicalistes appartenant aux Organisations confédérées, unitaires et autonomes, ont décidé de se réunir, d'avoir entre eux un échange de vues sur la situation de la classe ouvrière dans l'état actuel du monde économique et social.
Ils ont considéré que la concentration de plus en plus accentuée du Syndicalisme, que la force de plus en plus grande de l'organisation patronale et le développement de ses moyens de résistance et de réussite rendent chaque jour plus difficile l'action en vue d'améliorer les conditions d'existence des travailleurs.
Ils ont considéré, d'autre part, que le développement de la politique militariste du gouvernement, la course aux armements, l'extension du fascisme dans de nombreux pays européens placent les prolétariats devant le double péril de la guerre et de la dictature. Ils ont reconnu que l'état de dispersion et d'émiettement des organisations de la classe ouvrière permet au capitalisme, au militarisme et au fascisme toutes les audaces, tous les coups d'Etat, toutes les atteintes à la vie du prolétariat. Ils ont convenu qu'après dix années de duels fratricides il fallait faire effort pour mettre fin à la division des forces syndicales.
Ils se sont mis d'accord pour lancer l'idée de la reconstitution de l'unité syndicale dans une centrale unique, sur les bases de la Charte d'Amiens. La réalisation de cette idée ne se conçoit, à leur avis, que dans la pratique de la lutte des classes et dans l'indépendance du mouvement syndical, en dehors de toute ingérence des partis politiques, toutes fractions et toutes sectes ainsi que du gouvernement.
Ils précisent que chacun devra rester fermement attaché à son organisation syndicale propre, sans arrière-pensée, comme sans manœuvre, tout en y poursuivant la propagande en faveur de l'unité. Les camarades présents, convaincus que l'idée qu'ils viennent d'émettre rejoindra la pensée intime et les désirs profonds des ouvriers de ce pays, décident de se retrouver prochainement dans une réunion plus large à l'issue de laquelle un appel sera adressé à l'ensemble des travailleurs français.
Paris, le 9 novembre 1930.
PS : Les Militants syndicalistes de toutes tendances approuvant cette déclaration sont priés de faire connaître leur accord au camarade. R. Laplagne, 31, rue Dawton, Le Pré-Saint-Gervais (Seine)
Au nom des camarades présents. Pour les Confédérés : Marthe Pichorel, L. Digat, J. Toesca, P. Monatte, G. Dumoulin, C. Delsol, Roger Hagnauer. Pour les Autonomes : Roger Francq, M. Piquemal, R. Laplagne, J. Métayer, P. Martzloff, R. Mathonnet, G. Guilbot. Pour les Unitaires : A. Rambaud, V. Engler, Lucie Colliard, H. Boville, R. Deveaux, P. Cadeau, B. Bour, M. Chambelland ».
Paru dans la RP N°112 décembre 1930
En 1957, après la scission de 1947, trois éminents militants vont reprendre le Chantier de l'Appel des 22 - Denis Forestier pour la FN-Autonome, Roger Lapeyre pour la CGT-FO et Aimé Pastre pour la CGT - et lancer l'Appel Pour un Mouvement Syndical uni et Démocratique. Il y avait un peu la même illusion sur le fait de ne pas porter dans le Syndicalisme l'en-dehors des Partis politiques ; cela relève de la Pensée magique : Dire c'est faire. Il y avait, outre toujours la volonté unitaire de réunification, une autre dimension laïque qui n'était pas là en 1931 : « Le groupement des Travailleurs, sous l'égide d'une confession, relève de l'attachement à la conception du pluralisme syndical et, par-là, s'oppose en fait à la reconstitution syndicale et donc, en dernière analyse, sert les intérêts du Capitalisme national et international ».
Une revue qui embrasse beaucoup de sujets
et de thèmes très variés
● Féminisme : Sont publiés des textes de Jeanne Deroin qui polémique avec Pierre-Joseph Proudhon, qui n'était pas un adepte du Féminisme et de l'Égalité Hommes/Femmes. « Il était imbu de l'idée que la Femme était inférieure au triple point de vue de « physique, intellectuel et moral », et doit être cantonnée au foyer pour servir « d'auxiliaire à l'Homme » et être vouée à tout jamais « aux durs labeurs du foyer », à la soumission absolue au père, au mari et aux besoins du fils. » En réponse au fameux « Ménagère ou courtisane », celle-ci répondait : « l'Homme à la cité et à la famille, la Femme à la famille et la cité ».
C'est Ferdinand Buisson, Président de la Libre Pensée et de la Ligue des Droits de l'Homme qui, le deuxième avant la Première Guerre mondiale, déposera la proposition de loi pour décider du Droit de vote des femmes.
● Révolution Russe et URSS : La revue publiera de nombreux articles sur l'évolution stalinienne du premier État ouvrier et contre les Procès de Moscou en soutenant les persécutés et victimes du Stalinisme. Écriront sur ce thème Pierre Monatte, Maurice Chambelland, Roger Hagnauer, Robert Louzon, Alfred Rosmer, Daniel Guerin, Marcel Martinet, Victor Serge, Simone Weil, c'est-à-dire un panel brillant qui ferait bien des envieux aujourd'hui. L'état d'esprit de la RP n'est pas de prétendre incarner une « ligne », mais plutôt un espace de débats ouverts autour de valeurs communes qui ne vont pas sans divergences quelques fois profondes.
Quelques temps avant le 23 août 1939, date de la signature du Pacte Germano-Soviétique, qui fut un coup de tonnerre dans un ciel peu serein, elle le prévoit ainsi que le dépeçage de la Pologne. Maurice Chambelland dira alors : « Le fascisme sort renforcé de la nouvelle trahison de Staline ».
● Le Stalinisme et sa variété chinoise : La revue aborde dans cette continuité la révolte des Conseils en Hongrie en 1956 : « Quelle est la force principale sur laquelle nous devons compter dans la lutte contre la dictature et contre la guerre ? C'est évidemment la classe ouvrière. » La RP a parfois la plume acide : « Quant aux compères ou aux intoxiqués des partis « frères », parmi lesquels tant d‘intellectuels dont le cerveau fonctionne sans liaison avec les yeux, ils chantaient les louanges d'une démocratie populaire qui suivait les traces de l'Union soviétique, en pleine communion d'âme avec ses précurseurs, amis et protecteurs.
L'énorme mensonge a été crevé par un peuple unanime à rejeter, à vomir une dictature imposée par la force et la terreur ». On pourrait reprendre mot pour mot la formule sur « les intellectuels déconnectés » pour ceux qui osent nier aujourd'hui le génocide du Peuple palestinien. Un autre qui en prend aussi pour son grade dans la même « déconnection » est « Monsieur Étiemble » (1), surnommé « le Commis-pèlerin suppôt de Mao Tsé-Toung », laudateur zélé du stalinisme à la Chinoise.
« M. Étiemble se réjouit que le mot « Trotskisme » ne fasse plus partie du vocabulaire chinois, « pour la Chine quelle chance ! », car le duel Staline-Trotski « eut pour seul effet de pourrir la pensée marxiste ». Mais il ne mentionne pas que presque tous les Trotskistes chinois ont été assassinés par Mao Tse-Toung ».
« Tous les maîtres du monde actuel évoquent invariablement la barbarie, les crimes des régimes du passé pour voiler leur propre barbarie, leurs propres crimes aux yeux de leurs esclaves. M. Étiemble n'a fait qu'employer la même méthode que ceux dont il sert les intérêts. »
● Mai-juin 1936 : On y trouve sous la plume de Simone Weil des morceaux d'anthologie intemporelle, tant ils sont puissants : « Il s‘agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser. Se tenir debout. Prendre la parole à son tour. Se sentir des hommes, pendant quelques jours. Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie. Une joie pure. Une joie sans mélange....
L'idée de négocier avec les patrons, d'obtenir des compromis, ne vient à personne. On veut avoir ce qu'on demande. On veut l'avoir parce que les choses qu'on demande, on les désire, mais surtout parce qu'on relève la tête, on ne veut pas céder. On ne veut pas se laisser rouler, être pris pour des imbéciles. Après avoir passivement exécuté tant et tant d'ordres, c'est trop bon de pouvoir enfin pour une fois en donner à ceux mêmes de qui on les recevait. Mais le meilleur de tout, c'est de sentir tellement des frères...
Allons-nous enfin assister à une amélioration effective et durable des conditions du travail industriel ? L'avenir le dira ; mais cet avenir, il ne faut pas l'attendre, il faut le faire. »
Pierre Monatte s'interroge, lui : « Alors, des camarades de plus en plus nombreux se demandent avec inquiétude si le Front populaire n'est pas une sinistre duperie. Au lieu d‘un rassemblement pour la résistance à l'aggravation des conditions de vie, ne va-t-il être qu'un rassemblement pour la capitulation devant les décrets-lois ? Au lieu d‘un rassemblement pour la résistance au fascisme, qui est par essence un nationalisme, un nationalisme porté à l'exaspération, le Front populaire n'est-il que le prélude à l'Union sacrée de la prochaine guerre ? »
● L'Algérie : On parle beaucoup de Messali Hadj et de la manière dont se manifeste le désespoir impuissant de la confrontation sanglante MNA/FLN. Albert Camus y écrit à ce sujet : « Allons-nous laisser assassiner les meilleurs militants syndicalistes algériens par une organisation qui semble vouloir conquérir, au moyen de l'assassinat, la direction totalitaire du Mouvement algérien ? » Messali Hadj appelle à l'arrêt des assassinats entre Algériens : « Pour ma part, je me mets immédiatement à la disposition des bonnes volontés, d'où qu'elles viennent, car l'essentiel est que le sang cesse de couler et que les balles perdues ne fauchent plus dans la rue de malheureux passants. »
● La Laïcité et la Démocratie : Christian Mahieux fait une analyse précise contre les faux « laïques » qui usurpent ce titre dans une croisade contre les Musulmans, nous sommes entièrement d'accord avec cette analyse, je n'y reviendrai pas. Il cite aussi un texte fondamental de Lénine « De l'attitude du Parti ouvrier à l'égard de la religion » qui sous-tend notre analyse commune, texte dont il indique qu'il a été cité dans l'Idée libre, revue culturelle de la Libre Pensée. Rappelons que, pour les authentiques Révolutionnaires (Marx, Engels, Lénine, Trotski), la religion est une « affaire privée » du point de vue de l'État et absolument pas du point de vue du « Parti ouvrier ». Michaël Bakounine avait exactement la même position de principe, il affirmait que l'on ne pouvait être Anarchiste sans être Athée.
Est publié un large extrait d'un texte de Robert Louzon de 1925 « L'huile de ricin ou l'opium ? » où il traite de la Démocratie d'un point de vue que j'analyse comme extrêmement formel. À le lire, la « Démocratie bourgeoise » et le « Fascisme » ne sont que deux formes de la Dictature du Capital. C'est loin d'être faux dans l'absolu, mais ignorer les conditions dans lesquelles se forment et s'exercent ces deux formes de dictature ne peut qu'« impuissanter » le Mouvement ouvrier.
À partir du moment où le Capitalisme rentre dans sa phase finale « l'Impérialisme, stade suprême du Capitalisme », toutes les conquêtes démocratiques, arrachées dans l'ascension de la Bourgeoisie, ne peuvent être préservées, étendues, reconquises que par le Mouvement ouvrier dans sa lutte pour son Émancipation intégrale. Au contraire, le Capital ne peut que les remettre en cause, on le voit nettement aujourd'hui avec les lois « Sécurité globale » et « Séparatisme » qui détruisent littéralement les bases démocratiques historiques bourgeoises, ce qui crée une tension politique dans laquelle, si le Prolétariat s'insère, il fait « imploser » le carcan des contradictions institutionnelles, politiques et sociales et lui seul peut porter réellement ses revendications démocratiques.
● La Grève et des grèves : Le chapitre commence par le récit très détaillé des Penn-Sardin en 1925, les Sardinières de Douarnenez. C'est très fort et très émouvant aussi. La Libre Pensée y a consacré une émission de France-Culture où nous recevions l'auteure d'un ouvrage sur ce sujet.
D'autres grèves et mouvements sociaux sont analysés, comme la grève générale des PTT en 1953 contre les Décrets Laniel, en 1963 celle des mineurs et contre la réquisition de ceux-ci par le pouvoir gaulliste. Ces grèves monteront en puissance pour déboucher sur la grève générale de mai-juin 1968 qui verra sa concrétisation par la chute du général 2 étoiles en 1969. Depuis, le Régime issu du coup d'État du 13 mai 1958 entre en crise et en agonie. Ce chapitre se conclut par l'analyse de Christian Mahieux sur le Mouvement des grèves de 2023, article qui fit date pour les militants, sur le bilan du « Mouvement social » contre la Réforme des Retraites et ses conséquences sur et dans le Mouvement syndical.
Bien d'autres sujets sont traités dans LRP : l'antisémitisme, la Révolution espagnole, l'anticolonialisme, l'internationalisme, l'entre-deux-guerres, la production, la littérature et la philosophie, l'histoire du mouvement ouvrier, l'écologie. L'ouvrage se termine par la recension – non exhaustive – de toutes celles et de ceux qui écrivirent un jour dans la Révolution Prolétarienne.
La RP a été incontestablement une revue du Mouvement ouvrier et un moment du combat de celui-ci. La lecture de cet ouvrage qui rappelle tout cela est donc à recommander.
Christian Eyschen
La Révolution Prolétarienne (1925-2025) -Éditions Syllepse – 278 pages – 18€
Note :
1- René Étiemble, né le 26 janvier 1909 à Mayenne (France) et mort le 7 janvier 2002 à Dreux, connu sous le nom de plume d'Étiemble, est un écrivain et universitaire français, reconnu notamment comme sinisant éminent, spécialiste du confucianisme et du haïku et traducteur de poésie. [Il fut en France le premier pourfendeur du franglais avec son livre le plus connu Parlez-vous franglais ?, LGS].