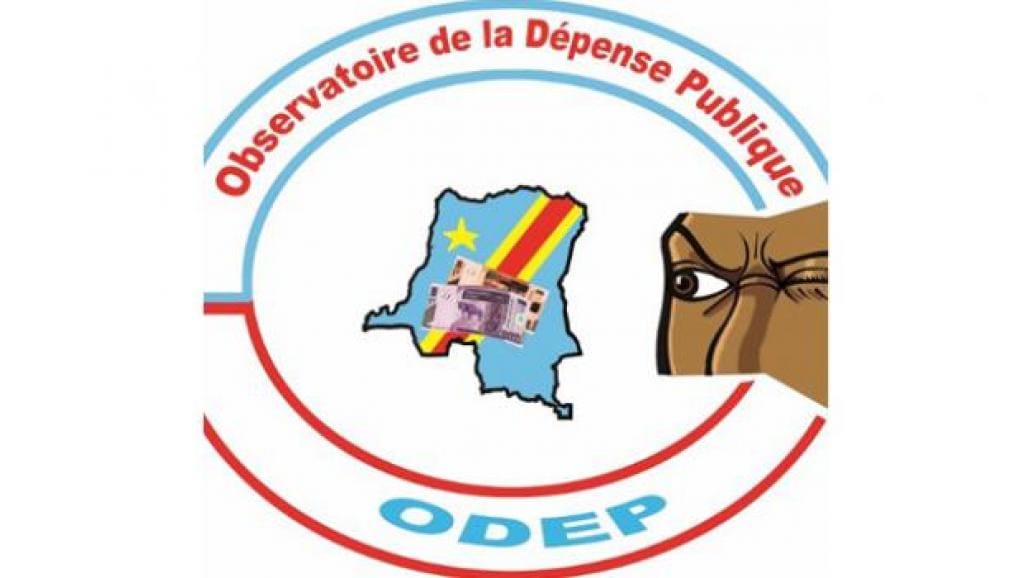Florimond MUTEBA TSHITENGE

Initiative de la Cellule de communication de l'ODEP (Observatoire de la Dépense Publique)
République Démocratique du Congo : La paix viendra des Congolais eux-mêmes et des pays frères d'une Afrique affranchie de l'esclavagisme et du néo-colonialisme et non des puissances occidentales et de leurs laquais locaux. »
« Il n'y a pas d'avenir pour un peuple qui remet le soin de sa libération entre les mains de ses oppresseurs. », Frantz Fanon.
Depuis l'aube du XXIe siècle, la République Démocratique du Congo est le théâtre d'un conflit long, insidieux et multiforme, échappant aux catégories classiques de la géopolitique. Ni guerre civile au sens strict, ni conflit frontalier, ni insurrection localisée : le drame congolais est un syndrome géopolitique hybride, où s'entrelacent les logiques de prédation économique, de luttes d'hégémonie régionale et de recomposition des sphères d'influence à l'échelle mondiale.
Dans l'Est du pays, où se concentre une part considérable des ressources stratégiques du continent africain, cobalt, coltan, or, tantale, lithium... Le sol est devenu plus précieux que la vie humaine.

Depuis le déclenchement des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus de six millions de personnes ont perdu la vie, selon les estimations les plus sérieuses. À ce lourd tribut s'ajoute le sort tragique de plus de sept millions de déplacés internes, contraints à l'exil au sein même de leur propre pays, chassés par les violences armées, les massacres et l'instabilité chronique.
Pourtant, ces femmes, ces hommes et ces enfants, privés de tout, ne bénéficient du Trésor public congolais que d'une aide annuelle de 150 francs congolais par personne, soit à peine quelques centimes de dollar. Une somme dérisoire, presque insultante, face à l'ampleur de la détresse. Cette réalité interroge la volonté politique réelle de protéger les plus vulnérables, et met en lumière les failles béantes de la solidarité nationale.
Face à cette catastrophe humanitaire d'une ampleur sans précédent en Afrique depuis le génocide rwandais, le silence complice des grandes puissances s'est mué en stratégie diplomatique assumée.
La guerre comme matrice d'un ordre extractiviste néocolonial
Les récits dominants peignent la guerre au Congo comme une succession « d'affrontements ethniques » ou de « rébellions endémiques ». C'est là une réduction délibérée, une ruse sémantique destinée à dissimuler l'architecture réelle du chaos : la mise en coupe réglée d'un État délibérément fragilisé, pour mieux garantir l'acheminement continu des matières premières vers les industries occidentales et asiatiques.
« La guerre, écrivait Clausewitz, n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. » Mais dans le contexte africain, et plus particulièrement congolais, elle apparaît bien davantage comme la continuité méthodique du pillage économique amorcé par la colonisation, consolidé par le néocolonialisme, et aujourd'hui perpétué par des forces impérialistes appuyées par leurs relais locaux.
Il ne s'agit plus seulement de conflits armés à des fins géopolitiques classiques, mais de véritables stratégies de captation des ressources, de déstructuration des souverainetés nationales, et de mise sous tutelle des économies locales, avec la complicité d'une certaine élite politique et économique africaine corrompue et prédatrice.

Le conflit se structure autour de trois piliers :
1. La militarisation des zones minières, assurée par des groupes armés dits « rebelles », recyclés au fil des ans sous divers sigles (AFDL, RCD, CNDP, M23/AFC).
2. Le soutien direct ou indirect de certains États voisins, en particulier le Rwanda et l'Ouganda, dont les armées servent désormais d'instruments logistiques au service du système capitaliste mondial.
3. La diplomatie ambiguë des puissances occidentales, oscillant entre condamnation rhétorique et soutien matériel, selon les intérêts géostratégiques du moment.
Les cinq vagues de la prédation armée : une chronologie structurée du désordre
Depuis l'indépendance en 1960, la République Démocratique du Congo peine à se doter d'un véritable parti politique de combat, porteur d'une doctrine révolutionnaire claire, capable de résister à l'impérialisme sous toutes ses formes. Un tel parti aurait pu non seulement encadrer les luttes internes, mais aussi guider notre politique nationale et internationale à travers une idéologie structurée, cohérente et affranchie des influences extérieures. Dans d'autres pays, des formations de ce type ont servi de colonne vertébrale à l'État : on pense notamment au Parti communiste de l'Union soviétique sous la direction de figures telles que Lénine et Staline, ou encore au Parti communiste chinois sous l'impulsion de Mao Zedong.
Ces partis n'étaient pas de simples structures électorales, mais de véritables instruments de transformation sociale, porteurs d'une vision claire du monde, capables de définir des priorités économiques, culturelles et diplomatiques. Le Congo, en revanche, est resté sans ce socle idéologique fort, naviguant entre influences étrangères et stratégies de survie, sans jamais pouvoir imposer sa propre voie.
L'expérience de Pierre MULELE, en 1964, fut l'un des rares prolongements cohérents du lumumbiste. Son engagement radical et patriotique portait en germe les fondements d'un nationalisme révolutionnaire authentique. Cependant, cette tentative, bien que riche en enseignements, ne connut ni prolongement durable, ni structuration politique capable d'influencer profondément les générations suivantes.
Ainsi, lors de l'avancée de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) en 1997, aucune force politique nationaliste révolutionnaire n'était véritablement en mesure d'accompagner, d'encadrer ou même d'orienter cette conquête du pouvoir. Le renversement du maréchal Mobutu, le 17 mai 1997, s'est donc opéré sans le socle idéologique ni l'organisation politique nécessaires à une refondation réelle de l'État.
Tout cela constitue la source profonde des difficultés que connaît encore le pays aujourd'hui. En l'absence d'un parti national et révolutionnaire capable de guider la lutte, le président Laurent-Désiré Kabila fut contraint de s'appuyer sur des forces extérieures, dont les ambitions, souvent prédatrices, ont fini par fragiliser davantage la souveraineté nationale d'autant plus qu'il n'a lui-même jamais réussi à en créer un, malgré les attentes qu'il suscitait.
Le conflit congolais s'inscrit dès lors dans une logique cyclique, chaque vague de crise s'enracinant à la fois dans des enjeux régionaux complexes et des dynamiques géopolitiques internationales, souvent instrumentalisées par des intérêts extérieurs.
1. 1998-2003 : La guerre d'occupation économique
C'est le temps de l'occupation directe. Les armées rwandaises et ougandaises, sous le prétexte sécuritaire de poursuivre des milices génocidaires, envahissent massivement le territoire congolais. Mais derrière ce voile diplomatique, se dessine la réalité brutale d'un projet de prédation territoriale et minière.
Les minerais du Kivu prennent alors le chemin de Kigali et Kampala, pendant que le chaos se généralise et que l'État congolais s'effondre. Le président Laurent-Désiré Kabila, tenté de rompre avec l'emprise étrangère et de reprendre le contrôle des ressources stratégiques, paiera cette volonté de souveraineté de sa vie. Avant d'être élevé au rang de martyr, le président Laurent-Désiré Kabila fut, dans les premières heures de son ascension, un complice consentant de la stratégie des puissances étrangères qui, plus tard, se retourneront contre lui. Séduit par la perspective d'accéder au pouvoir, il renonça à l'idéal d'une lutte souveraine, échouant à bâtir une armée nationale de libération comparable à celle du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA) ou du Front de Libération Nationale (FLN) en Algérie. Ce choix celui de recourir aux troupes étrangères fut une erreur historique, longtemps occultée par le prestige posthume de son sacrifice.

L'accord de Sun City en Afrique du Sud, signé en 2003, met officiellement fin aux hostilités. Mais ce n'est qu'un vernis diplomatique sur des braises encore ardentes : les réseaux de prédation, eux, sont en place. Le Congo est devenu un gisement à ciel ouvert sous surveillance militaire étrangère.
2. 2004 : L'épisode Mutebutsi - La guerre furtive
À peine les accords de Sun City ont-ils été signés que les armes reprennent la parole dans les collines de l'Est. La paix, encore fragile, à peine conçue, est étranglée dans son berceau.
Nous sommes en mai 2004. Un nom resurgit dans les ténèbres congolaises : le colonel Jules MUTEBUTSI. Ancien officier des FARDC passé à l'insurrection, il avance avec ses hommes vers la ville stratégique de Bukavu. À ses côtés, des militaires bien entraînés, lourdement armés, et selon de nombreux rapports indépendants, soutenus dans l'ombre par le Rwanda.
Bukavu tombe en quelques jours, sans que l'État congolais ne parvienne à réagir efficacement. Les rues deviennent un labyrinthe de peur. Les populations civiles, piégées entre les lignes, ne comprennent plus les codes de la guerre, ni les visages de ceux qui les terrorisent.
Pénétrations domiciliaires, viols massifs, assassinats ciblés, humiliations publiques : le Sud-Kivu bascule dans une terreur nue, silencieuse, insoutenable.
Les témoignages se multiplient, bouleversants, mais demeurent largement ignorés. La communauté internationale, trop empressée de qualifier la région de «post-conflit», choisit de détourner le regard. « Parler de réconciliation sans vérité, c'est imposer le silence au lieu de soigner les blessures », rappelle avec justesse Georges Nzongola-NTALAJA. Cette citation sonne comme une mise en garde : en République démocratique du Congo, on enjoint les victimes au pardon sans avoir nommé les crimes. La guerre a changé de visage elle s'est institutionnalisée sous forme d'un désordre minier structuré, dissimulé derrière une instabilité que l'on présente comme chronique.
Ce qui se déroule à Bukavu dépasse le cadre d'une simple offensive : il s'agit de la manifestation d'un système. Un modèle où l'État est affaibli, la justice inexistante, et la souveraineté compromise.
Le mutisme des instances diplomatiques face à cette situation ne relève pas de la négligence. Il traduit une forme de complicité.
3. 2009 : Laurent Nkunda et la contractualisation de la violence
Un autre nom émerge des ombres de l'Est : Laurent NKUNDA. Général auto-proclamé, ancien officier devenu chef rebelle, il s'impose à la tête d'un mouvement armé qui défie l'État congolais.
Son objectif ? Goma. Une ville stratégique, convoitée, déjà marquée par les secousses des guerres passées.
Les combats s'intensifient. Les populations fuient. Les chancelleries s'alarment. À mesure que les rebelles avancent, la tension grimpe. L'Est du Congo devient le théâtre d'un brasier aux allures de conflit régional.
Face au risque d'embrasement total, un accord est arraché entre Kinshasa et Kigali. Un texte signé à la hâte, dicté par la peur du pire, mais vidé de toute profondeur.
Une trêve. Pas une paix.
Car sur le terrain, les armes ne se taisent jamais longtemps. Le silence qui suit n'est que celui d'un orage qui prépare son retour.
4. 2012 : le M23 - Mutation génétique du chaos
Puis vient le M23. Héritier direct des rébellions précédentes, recyclage de rancunes et de stratégies militaires, ce mouvement surgit comme un fantôme déjà connu, porteur d'un chaos savamment orchestré.
Le groupe avance avec méthode, discipline, appui logistique. Goma tombe. Encore.

L'humiliation est totale.
La population, épuisée par les exils répétés, regarde une fois de plus sa ville basculer entre les mains de ceux qui prétendent libérer en semant la terreur.
Mais cette fois, la riposte s'organise.
Une coalition improbable se forme : les FARDC, trop souvent débordées, bénéficient de l'appui musclé d'une brigade d'intervention de la MONUSCO, une force exceptionnelle, dotée d'un mandat offensif, avec à ses côtés des troupes sud-africaines aguerries.
5. 2021-2025 : le retour stratégique et la militarisation économique
Elle est la plus redoutable dans sa métamorphose.
Le M23 ne ressuscite pas : il se réinvente. Tel un phénix noir nourri par la poudre et l'or, il surgit des ténèbres du Kivu, plus discipliné, mieux équipé, et toujours adossé à l'ombre tutélaire du Rwanda comme le confirment, inlassablement, rapports onusiens et analyses indépendantes.
En 2025, l'impensable redevient réalité : Goma tombe, une fois encore. Dans un silence assourdissant, les bottes rebelles écrasent les routes vers Bukavu, lorgnent le Katanga, effleurent Kisangani. Mais il ne s'agit plus d'une simple guerre de rébellion : c'est une guerre d'occupation minérale, une guerre froide aux allures brûlantes, où chaque colline est un gisement, chaque rivière une frontière stratégique.
Un chercheur congolais résume, avec une amertume lucide :
« Ce qui change, ce ne sont pas les acteurs, mais les étiquettes. Les visages se remplacent, les intérêts demeurent. »
Et tout est dit. Le théâtre congolais reste le même : seuls les costumes et les noms varient.
Ce n'est plus une guerre, c'est une mise en scène tragique du pillage organisé. Le drame congolais continue, chaque acte plus violent que le précédent, chaque silence plus complice.
L'occident entre duplicité diplomatique et schizophrénie stratégique
Si l'on devait résumer la posture des puissances occidentales, on pourrait l'intituler : « condamner à Bruxelles, financer à Kigali ». En effet, malgré les rapports accablants de l'ONU sur l'implication directe de l'armée rwandaise dans les offensives du M23, l'Union européenne signe en 2024 un accord commercial stratégique avec le Rwanda pour l'accès aux minerais dits « stratégiques ».
« L'UE est en train de signer des contrats avec ceux qui incendient la maison, tout en envoyant des pompiers sans eau. », ironise un analyste géopolitique africain.
La logique est implacable : garantir l'accès aux ressources sans se soucier de la légitimité politique. Face à une classe dirigeante instable, parfois ambivalente, et un peuple profondément attaché à sa souveraineté mais souvent trahi de l'intérieur les puissances étrangères choisissent délibérément de contourner l'État congolais. Elles privilégient des accords opaques avec les pays voisins, fermant les yeux sur l'illégalité flagrante de ces ingérences, tant que l'objectif économique est atteint.
La Belgique, de l'état tueur a l'état amnésique
Dans le concert des puissances complices de la déstabilisation du Congo, la Belgique occupe une place à la fois singulière, historique et tragiquement persistante. Héritière d'un passé colonial brutal, elle n'a jamais véritablement rompu avec sa logique d'ingérence. Son implication directe dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, de Pierre MULELE et de nombreux autres compagnons de lutte, son soutien actif à la sécession du Katanga et le Sud du Kasaï, ainsi que sa promotion de Mobutu comme rempart supposé contre le communisme, témoignent d'une volonté constante de modeler l'avenir politique du Congo selon ses propres intérêts. À travers un jeu d'influences, d'alliances souterraines et d'interventions diplomatiques discrètes mais efficaces, la Belgique s'est maintenue, depuis l'indépendance, comme l'un des acteurs majeurs de la fragilité structurelle congolaise.

La RDC dans l'échiquier multipolaire : enjeu du XXIᵉ siècle
Le monde bascule. La domination occidentale s'effrite, et les BRICS avancent. Dans ce nouvel ordre en gestation, la RDC est une pièce maîtresse : pivot énergétique, centre logistique continental, et réservoir minier global.
« Celui qui tient le Congo tient la colonne vertébrale de l'Afrique. », résumait un diplomate russe.
Mais ce basculement inquiète l'Occident. C'est pourquoi il entretient le flou : condamnation molle du Rwanda, maintien des aides, infiltration de l'élite congolaise, fragmentation des alliances régionales. Tout cela dans un seul but : empêcher la RDC de se positionner comme puissance émergente panafricaine.
Vers une paix indigène, endogène et souveraine
La solution ne viendra pas de l'ONU, ni de Washington, ni de Bruxelles. Elle viendra d'un sursaut collectif africain, d'une alliance géostratégique continentale, et d'une refondation institutionnelle congolaise autour de trois piliers :
1. La souveraineté militaire et technologique, en rompant avec les modèles de dépendance sécuritaire.
2. L'intégration régionale stratégique s'articule autour de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), et d'un axe de coopération Sud-Sud à vocation anti-impérialiste.
3. L'ancrage dans la mémoire historique, pour décoloniser non seulement les ressources, mais aussi les imaginaires.
« Nous ne voulons pas d'une paix importée dans des caisses de diplomatie. Nous voulons une paix qui pousse comme un arbre sur notre propre sol. », Proverbe bantou
Conclusion : sortir du piège de la paix instrumentalisée
La paix ne peut être un produit d'exportation. Elle ne peut être construite par ceux qui bénéficient de la guerre. L'Afrique doit choisir : s'unir ou s'effondrer. Et le Congo, par son histoire, son poids et son potentiel, doit redevenir le cœur battant de cette renaissance continentale.
« Je ne suis pas venu pleurer sur le sort de l'Afrique. Je suis venu l'appeler à se lever. », lançait Patrice LUMUMBA dans un cri d'espoir et de combat. Paraphrasant ce mot d'ordre fondateur, le lumumbiste Florimond MUTEBA conclut son ouvrage « Un avenir pour la République Démocratique du Congo », publié en juillet 2024, par un appel tout aussi visionnaire : « L'Afrique n'a pas le dos au mur face au monde de demain. Nous disposons de nombreuses possibilités, de véritables atouts, pour peu que nous sachions poser un regard lucide sur l'avenir et mobiliser les forces encore inexploitées de notre continent. »
Fait à Kinshasa, le 28 Mars 2025, Pour l'Observatoire de la Dépense Publique.
Florimond MUTEBA TSHITENGE, Président du Conseil d'Administration.

L'Observatoire de la Dépense Publique (ODEP) est une organisation non gouvernementale créée le 01 juillet 2011 par un groupe de douze organisations de la société civile de la RDC, soucieuses de promouvoir les finances publiques en tant que question de promotion sociale.
Source : Tribune d'expression libre de l'ODEP