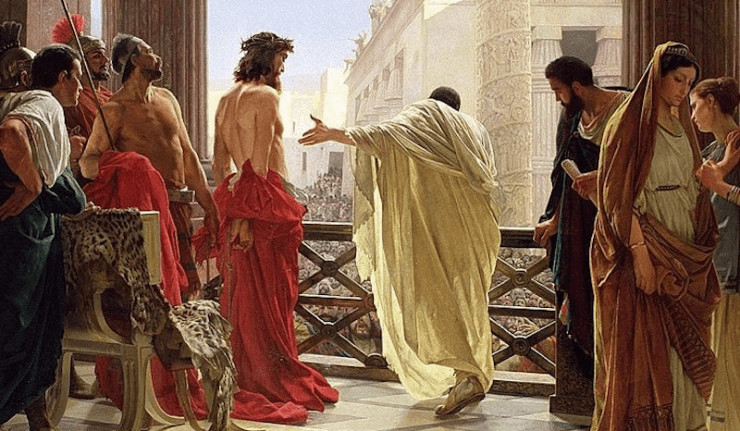
par Laurent Guyénot
En plus d'autres livres contestant l'existence historique de Jésus, j'ai lu les ouvrages suivants, écrits par des auteurs dits «mythistes» :
- Earl Doherty, The Jesus Puzzle (1999) ;
- Robert M. Price, Deconstructing Jesus (2000) ;
- Richard Carrier, On the Historicity of Jesus (2014).
La thèse mythiste affirme, selon Doherty, que Paul et les premiers chrétiens considéraient Jésus comme «une figure entièrement spirituelle qui n'opérait que dans la partie surnaturelle/mythique de l'univers» et ne savaient rien du Jésus terrestre des Évangiles. De même, selon Carrier, «le Jésus que nous connaissons est à l'origine un personnage mythique» et ce n'est que «plus tard que ce mythe a été confondu avec l'histoire (ou délibérément présenté comme tel)».
Le consensus académique est que Jésus était un homme qui a été transformé en être divin après sa mort par ses disciples, puis, à un stade ultérieur, en Dieu lui-même. Les mythistes affirment au contraire que le Christ a d'abord été vénéré comme une entité divine, avant de se voir attribuer une biographie humaine : il est un dieu devenu homme.
Il est intéressant de noter que la thèse mythiste ressemble à la christologie élaborée par les Pères de l'Église : le Fils de l'homme est descendu du ciel pour s'incarner dans la chair. En d'autres termes, en inversant le consensus scientifique, les mythistes finissent par dire la même chose que la théologie chrétienne, sur un plan différent.
Le Christ de saint Paul
Outre l'extrême rareté des sources non-chrétiennes mentionnant l'homme Jésus avant le milieu du IIe siècle (Tacite et Flavius Josèphe), dans lesquelles on soupçonne des interpolations chrétiennes, le point de départ des mythistes est l'observation que Paul montre très peu de connaissances et/ou d'intérêt pour la vie terrestre de Jésus. «Ni Paul, ni aucun autre auteur d'épîtres du premier siècle n'identifie leur divin Christ Jésus au récent personnage historique connu par les Évangiles. Ils n'attribuent pas non plus les enseignements éthiques qu'ils proposent à un tel homme» (Doherty). Le fait que Paul ait reçu sa foi «non pas d'un homme», mais «par une révélation» (Galates 1,12) n'explique pas entièrement pourquoi, après avoir rencontré Jacques, le frère de Jésus, et Pierre, le premier apôtre de Jésus, à Jérusalem, Paul ne fait toujours aucune mention de la vie de Jésus et ne cite jamais ses paroles. Les mythistes ne nient pas que Paul parle de la crucifixion, de la mort, de l'enterrement et de la «résurrection d'entre les morts» de Jésus (Galates 2,20 ; 1 Corinthiens 15,3-20), mais ils soutiennent que, dans l'Antiquité, on admettait que certains dieux subissaient un tel processus. Ainsi, selon Doherty, le Christ est pour Paul une divinité céleste qui a enduré l'épreuve de l'incarnation, de la mort et de la résurrection, et qui communique avec ses fidèles à travers des rêves, des visions et des prophéties. Ce que les mythistes ont plus de mal à expliquer, c'est que Paul appelle également Jésus «homme», «descendant de David selon la chair» et «né d'une femme, sous la loi» (Romains 1,4 et 5,15-19 ; Galates 4,4). Paul mentionne également Jacques, «le frère du Seigneur» (Galates 1,19), mais les mythistes interprètent «frère» (adelphos) comme désignant une catégorie particulière d'adeptes. Malgré ces difficultés, admettons que, sur la seule base du silence relatif de Paul sur la vie de Jésus, le mythisme n'est pas une hypothèse absurde.
Elle est cohérente avec la chronologie standard. En fait, elle repose entièrement sur celle-ci. C'est parce que les lettres de Paul sont antérieures aux premiers évangiles qu'il est possible d'affirmer que la perception de Paul du Christ comme un être divin a précédé l'invention du Jésus humain dans les évangiles. Comme Paul a écrit entre 58 et 63, moins de trente ans après la mort présumée de Jésus, il est difficile d'expliquer, selon les mythistes, comment un Jésus humain aurait pu être transformé en un Christ divin en si peu de temps, durant la vie de ceux qui l'ont connu dans la chair.
S'il pouvait être prouvé que les lettres de Paul ont en fait été écrites après les Évangiles, la théorie mythiste s'effondrerait complètement. Il convient donc de mentionner que l'opinion selon laquelle la version qui nous est parvenue des lettres de Paul date du IIe siècle n'est pas rare. L'argument le plus solide est qu'il n'existe aucune citation de Paul avant le début du IIe siècle. Certains érudits pensent que les lettres de Paul n'ont pas seulement été rassemblées par Marcion au IIe siècle, comme on l'admet généralement, mais qu'elles ont en fait été écrites au IIe siècle.
Mais supposons que les mythistes aient raison sur la chronologie. Il faut alors expliquer, premièrement, pourquoi Paul montre si peu d'intérêt pour le Jésus humain et, deuxièmement, comment un Jésus humain a pu être divinisé si rapidement après sa mort. Comme nous le verrons, le second point est facile à expliquer, car les exemples de ce processus sont nombreux : il s'agit de l'héroïsation. Dans le monde hellénistique, l'héroïsation, qui consiste à transformer un homme mort en un demi-dieu immortel, peut être presque instantanée.
Fils de Dieu
Selon la définition de Lewis Farnell : «Le héros, au sens religieux grec, est une personne dont la vertu, l'influence ou la personnalité étaient si puissantes de son vivant ou en raison des circonstances particulières de sa mort que son esprit après la mort est considéré comme doté d'un pouvoir surnaturel, demandant à être vénéré et apaisé». L'héroïsation implique la mythification, et plus généralement l'introduction de deux mythèmes classiques dans la légende du héros : premièrement, l'immortalité spéciale attribuée au héros mort est transformée en affirmation selon laquelle il a échappé à la mort, devenant immortel comme les dieux (appelons cela le mythème de l'Immortalité) ; deuxièmement, sa nature quasi divine est rétroprojetée vers sa naissance, par l'affirmation qu'il a été engendré par un dieu, étant donc un fils de dieu (le mythème de la Nativité).
Ce processus a été mis en évidence dans le cas de Jésus, par ce qu'on appelait autrefois la critique des formes et la critique des sources, l'étude scientifique de l'histoire rédactionnelle des Évangiles, de la tradition orale au canon final. Voyons d'abord comment Jésus est devenu le Fils de Dieu.
Dans les premiers mots de son Épître aux Romains, Paul écrit que, selon l'evangelion («bonne nouvelle») qu'il a reçue, Jésus «a été désigné Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts» (Romains 1,4). Les spécialistes sont d'avis que Paul n'invente pas ce credo, mais qu'il répète un ancien credo pré-littéraire connu de lui et de la communauté à laquelle il s'adresse. La même idée apparaît dans un discours attribué à Paul dans Actes 13,32-33.
Dans le plus ancien des évangiles, l'Évangile selon Marc, Jésus est fait «fils de Dieu» par «adoption» quand, durant son baptême par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit descend sur lui et une voix du ciel déclare : «Tu es mon fils bien-aimé» (Marc 1,11). On a avancé que l'épisode de la Transfiguration, lorsque la même voix dit aux apôtres, en parlant de Jésus «transfiguré», «Celui-ci est mon fils bien-aimé» (Marc 9,7), est à l'origine un épisode de résurrection qui a été déplacé, et qui donc reflète l'étape antérieure.
Marc ne sait rien d'une prétendue conception surnaturelle de Jésus. Ce sont seulement les récits de la Nativité de Matthieu et Luc, écrits après Marc, qui ont fait de Jésus un «fils de Dieu» par «conception», lorsque le Saint-Esprit descend sur la vierge Marie. Alors que jusqu'à présent, être le Fils de Dieu n'avait rien à voir avec la génétique et tout à voir avec l'esprit, Jésus est désormais le Fils de Dieu parce qu'il n'est pas le fils de Joseph.
Plus tard encore, dans le quatrième évangile (Jean), Jésus était Fils de Dieu (et Logos) avant d'être «envoyé dans le monde» (3,17). Il n'est pas devenu Fils de Dieu lorsque Marie l'a conçu, mais était Fils de Dieu de toute éternité. Le credo de Nicée inscrira dans le dogme l'idée Jésus, Fils unique de Dieu, est aussi ancien que Dieu lui-même et a créé toutes choses.
Nous pouvons résumer ce processus de mythification en quatre étapes :
- Jésus est devenu le Fils de Dieu par sa résurrection, c'est-à-dire par ses apparitions posthumes (Romains 1,4) ;
- Jésus est devenu le Fils adoptif de Dieu par son baptême (Marc 1,9-11) ;
- Jésus est devenu le Fils de Dieu par sa conception (Nativités de Matthieu et Luc) ;
- Jésus était le Fils/Logos de Dieu avant la création du monde (Jean), «consubstantiel» à Dieu (Nicée).
Dans cette séquence, nous avons la preuve la plus claire d'un processus de mythification par lequel Jésus a été transformé d'un homme en un dieu. Pour que la théorie mythiste soit correcte, il faudrait imaginer le processus inverse se déroulant avant la rédaction de l'Évangile de Marc, par lequel quelqu'un aurait transformé Jésus d'un dieu en un homme, lui inventant une vie bien remplie mais courte, comprenant un voyage à pied de la Galilée à Jérusalem. Il faut de surcroît admettre que, lorsque les théologiens et les évêques ont décidé de faire à nouveau de Jésus un être divin, ils ont été gênés par certains épisodes trop humains de sa biographie inventée (comme le fait qu'il ait eu des frères). Un tel processus en yo-yo est sans équivalent et n'a tout simplement pas de sens.
Nous avons également trouvé, en cours de route, la meilleure explication au manque d'intérêt de Paul pour le Jésus terrestre : les chrétiens d'aujourd'hui croient que Jésus était le Fils de Dieu dès sa conception, ou depuis l'éternité. Mais Paul et les premières communautés chrétiennes avec lesquelles il était en contact ne partageaient pas ce point de vue : ils considéraient que le Fils de Dieu n'était apparu qu'après la mort de Jésus, par une grâce spéciale de Dieu qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts (en esprit, pas en corps). Ils adoraient le Jésus ressuscité, pas le Jésus terrestre. Pour eux, le christianisme a commencé avec la résurrection, et non avec la nativité. Ils n'étaient donc pas très intéressés par les paroles de Jésus (il existe d'ailleurs des doutes quant à savoir si Q est à l'origine un recueil des paroles de Jésus, car certaines logia semblent avoir été attribuées à Jean-Baptiste avant d'être réattribuées à Jésus).
Enfin, nous avons également un indice sur la raison pour laquelle Jacques, qui semblait penser que son frère était fou pendant son ministère en Galilée (Marc 3,21), est devenu une figure de proue de l'Église de Jérusalem après avoir reçu une vision du Jésus ressuscité (1 Corinthiens 15,7). Comme Paul, Jacques avait une relation avec Jésus ressuscité, quelle qu'ait été sa relation avec Jésus vivant.
Résurrection
Après le mythème de la Nativité, étudions l'évolution du mythème de l'Immortalité, ou Résurrection, facilement retraçable elle aussi.