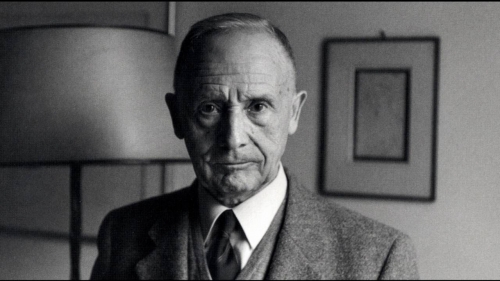
Claude Bourrinet
Source: Page Facebook de Claude Bourrinet
L'idée (une des idées), ou plutôt l'image, la chiquenaude qui met en branle l'imagination, ou, si l'on veut, le cerf-volant que l'on envoie dans les airs pour capter la foudre, le déclencheur, donc, qui pré-valut à la rédaction du Rivage des Syrtes, fut la tentation forte de décrire une bataille navale. L'enfant Gracq suivait avec passion, sur les cartes reproduites par L'Illustration, les affrontements des flottes de guerre allemande et anglaise, notamment ce choc des Titans que fut la bataille du Jutland, le 1er juin 1916. Cependant, celle qui aurait dû avoir lieu, entre la flotte d'Orsenna et celle du Farghestan, non seulement ne fut pas écrite, mais elle n'eut pas lieu. « Les beaux cavaliers qui sentent l'herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d'ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent » envahirent le territoire d'Orsenna sur terre, par le Sud, par le désert.
D'aucuns pourraient s'avouer déçus: une sorte de bataille de Lépante aurait fait bel effet, dans un roman plus ou moins historique (entre l'Antiquité et la Renaissance, entre Mithridate et Venise, il est vrai) ; mais voilà, une sorte de logique romanesque a empêché Gracq de la peindre. Ses « marines », ce sont les vagues qui giflent les côtes bretonnes. Mais, plus que la dimension réaliste (ou romantique), plus que l'anecdote pittoresque, qui manqueraient à l'œuvre, c'est plutôt une certaine conception de la littérature qui est affirmée par l'ellipse. L'écriture romanesque ne vise pas à montrer les choses, mais à en saisir, par les sens et l'intuition, la logique de leur survenue. Ce qui compte, ce n'est pas l' « événement » (il n'y en a guère, chez Gracq), mais ce qui le rend possible, comme l'étreinte pesante et lourde du ciel orageux présage l'éclair et le tonnerre. Tout est dans l'attente intense de cela même qui doit donner sens. Tout le récit du Rivage des Syrtes est la narration d'un crescendo fatal d'une énergie tellurique (symbolisée par le volcan Tângri, qui se profile à l'horizon de la terre farghestane), à travers les expériences sensorielles et passionnelles du héros Aldo. L'orage, qui est le destin de l'Histoire, ne nous est pas donné. On sait seulement, au détour d'une phrase, qu'Orsenna a été détruite par les « barbares ».
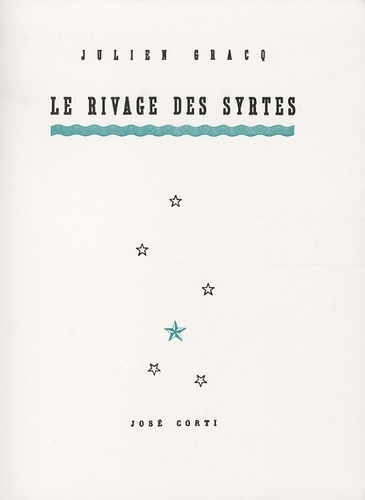
Cette charge électrique saturant l'atmosphère prête à crever en cataractes de sang, nous l'avons connu avant les coups de feu du 28 juin 1914, à Sarajevo, où Nedeljko Čabrinović fut une sorte d'Aldo. Mais le héros de Gracq n'est pas nationaliste, et ne médiatise, dans son geste provocateur, aucune idéologie. Les trois coups de canon provenant des batteries côtières faghestanes, sonnent comme un lever de rideau théâtralisé. L'Histoire est une scène où les morts sont vraiment morts, certes, mais Gracq se présente comme le spectateur, et directeur de cet « opéra fabuleux » porté par une trajectoire imaginaire, qui peut, au demeurant, s'apparier à celle d'un individu.
Pourtant, beaucoup de commentateurs n'ont pas manqué d'établir un parallèle entre le désastre annoncé, et la montée du nazisme, vecteur de guerre et de destructions massives. A ce compte, Aldo fut un « collabo », puisqu'il fut appelé à désirer l'offensive désastreuse de l'ennemi, poussé par le désir ardent de transgresser la loi, de franchir la ligne maritime interdite depuis des siècles, déclenchant ainsi sciemment l'apocalypse. Il semble évident que le roman recèle une portion non négligeable de nietzschéisme. En outre, Gracq était alors un grand lecteur d'Oswald Spengler et de Ferdinand Lot. Mais il a pris des distances par rapport aux thèses « dangereuses » de l'auteur du Déclin de l'Occident, ainsi que de Toynbee, qui expliquait, comme Ibn Khaldoun avant lui, l'effondrement des Empires par la conjonction entre les invasion barbares, et la défection insurrectionnelle du « prolétariat » intérieur (ou, dans le roman, par la rébellion d'une famille de rebelles, les Aldobandi, à laquelle Vanessa, qui tient un rôle capital, appartient).

Il considérait surtout ces deux historiens (ou philosophes de l'Histoire) comme des « poètes de l'Histoire », des pourvoyeurs d'archétypes. Les légendes, les mythes, sont des générateurs de motifs imaginaires. L'épopée des Nibelungen (étymologiquement « Ceux du brouillard), par exemple, si chère au wagnérien Gracq, pourrait entretenir maints liens avec Le Rivage des Syrtes ; Aldo, alors, ne serait pas Siegfried, mais le « traître » Hagen, celui qui déclenche tout. A moins, plus justement, qu'il ne soit Kriemhild, qui épouse le roi des Huns, pour se venger, et provoquer le massacre du roi Gunther, et de ses frères. Mais il n'est pas mu par le ressentiment, bien que le résultat soit de même portée. Toutefois, la "liberté" provocatrice, quoique pourvoyeuse de jouissance et d'ivresse, s'avère être une illusion. Une fois le branle donné, le dynamiteur n'aura été qu'un rouage d'une machine qui le dépasse infiniment, et qui poursuit une marche froide et inexorable.
C'est en poète, en visionnaire, que Gracq s'enquiert de la décadence. Qu'importe du reste si elle est occidentale ou non. Il acquiesce au concept d'entropie. Ses images sont, comme chez Spengler, ou Michelet, biologiques. « Tout ce qui existe mérite de périr ». Et il ajoute volontiers, à cette assertion de Hegel, « surtout si le corps est usé, miné par l'âge et la sclérose, vermoulu, et qu'un coup de botte suffit à ébranler jusqu'au fracas de la chute ». Orsenna est bâtie sur des couches superposées d'ossements, de cadavres. Elle est une ancienne puissance qui se survit, juchée sur une mémoire sénile de ressassement d'une gloire évanouie. Sa pulvérisation est donc logique. Le fonctionnaire Marino, fidèle capitaine et gardien de la forteresse maritime des terres du Sud, incarne l'enracinement dans le culte de la Terre et des Morts, et son barrésisme est condamné par le narrateur, lorsqu'il se noie dans la vase puant le cadavre et le bois pourri qui clapote au pied du quai de l'arsenal.

Gracq a rarement évoqué les événements historiques, ni ne s'est engagé après 1938, date à laquelle il a rompu avec le Parti communiste, dix ans après avoir perdu l'habitude de se rendre à la messe. Son sens de l'Histoire doit beaucoup à Chateaubriand, non par une posture « réactionnaire », voire royaliste, qu'il n'eut jamais (bien que né à Saint-Florent-le-Vieil, haut lien des exploits de l'armée de Vendée, et tombeau de Bonchamps), et, si l'on excepte quelques références historiques parsemées, à titre d'exempla, dans ses fragments critiques, il n'évoqua la guerre qu'à travers ses souvenirs de la bataille de Dunkerque – au sens large -, à laquelle il participa en tant que lieutenant. Jamais il ne s'engagea pour un parti ou un autre, quoiqu'il partageât un certain conservatisme « provincial » avec une certaine droite. Il accepta plusieurs invitations de Pompidou, mais uniquement parce que ce dernier avait été l'un de ses condisciples à l'École Normale supérieure. Son refus de dédicacer Les eaux étroites, dans une édition d'art offerte par l'illustrateur à Mitterrand, tenait probablement à la répugnance que lui inspirait le personnage. Sa «ligne», pour autant qu'on le sache par son silence massif à ce sujet, tient en un apolitisme inflexible. Cela ne l'empêchait pas, néanmoins, de jeter des lueurs de compréhension avertie sur des tendances majeurs de l'actualité mondiale (par exemple, son refus de l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne). Il ne rejetait pas non plus toute nouveauté. L'abattage des haies du bocage vendéen et breton le réjouit, car il lui permettait de jouir de larges échancrures par lesquelles s'offraient des perspectives et des panoramas que l'amateur de paysages – comme « presbyte » - recherchait.
La question de la rédemption historique est loin d'être résolue dans l'œuvre gracquienne, qui baigne cependant en partie, du moins dans sa composante romanesque, dans l'Histoire (Le Rivage des Syrtes, Un balcon en forêt), tandis que sa seule pièce de théâtre, Le Roi pêcheur, évoque la possibilité du salut, d'un salut qui n'est pas chrétien (Gracq a rejeté toute interprétation chrétienne du mythe du Graal). Le Roi pêcheur finit dans l'incertitude, et l'attente a tout lieu de persister. Le personnage féminin de Kundry est, selon l'auteur, son « porte-parole » : elle est déchirée, comme Baudelaire, entre deux postulations, entre la caducité de la nature humaine, qu'on peut appeler le « péché », et l'espoir, la quête de la grâce. Mais ce n'est pas de ce côté-là que Gracq trouve une issue à l'enfermement, au nihilisme contemporain.
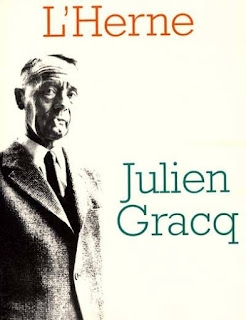
Au fond, toute son œuvre consiste en un refus de l'Histoire. Dans Le Rivage des Syrtes, ce rejet est incarné par le barrésien Marino, qui considère que le seul mouvement possible est l'immobilité. Dans le roman, il serait un élément « négatif » si Aldo ne l'était pas lui-même, à la manière du Méphistophélès de Goethe, de celui qui nie (Der Geist der stets verneint). Le diable empêche Faust d'accéder au salut, du moins tente de le faire, mais, d'un autre côté, sa négation a une fonction dialectique : elle stimule le mouvement, le questionnement et le progrès en défiant l'ordre établi. S'il ne faut pas tomber dans la facilité périlleuse d'associer un auteur à ses personnages, on peut néanmoins considérer que Gracq partage les visions aussi bien d'Aldo que de Marino (que le jeune héros stendhalien dit « aimer »). En 1959, il trouve à Venise, comme Chateaubriand et Barrès avant lui, le bonheur d'un lieu enchanté, hors des délires vertus et nietzschéens de l'Histoire, des folies sanguinaires des réformateurs du genre humain, comme Robespierre ou Lénine (dont il goûtait, par ailleurs l'allégresse et l'humour).
Gracq passe, en littérature, pour un « passéiste », voire un réactionnaire. Il a déclaré, avec son ironie mordante que, par moment, il déployait (songeons à son pamphlet, « La Littérature à l'estomac », où il pourfend les « Aristarque » de la critique littéraire), qu'en France, la littérature, du moins la production de grands écrivains, avaient cessé après le XIXe siècle. Son style, très maîtrisé, aristocratique quelque peu, hautain disait certains, et exigeant un lecteur lent et scrupuleux, désignait en lui un adversaire du laisser-aller, de la « libération » de la libido créatrice (ce qui était un contresens : rien de plus érotique, sensuelle, que la prose poétique de Gracq, qui, paradoxalement, est bien plus proche d'une hypothétique « avant-garde » - bien qu'il réprouvât et le terme, et l'idée – pour peu qu'on fasse l'effort de reconnaître en lui la « liberté grande » sans cesse en exercice, qui préside à son travail d'écriture, bien éloignée du conformisme salonnard et universitaire des Écoles littéraires en -isme de l'après-guerre).
Gracq était attaché à une certaine authenticité de vie, et de relation avec le monde. Il la trouvait dans ses liens avec la nature. Ce n'est pas un hasard s'il prisait par-dessus tout la rudesse dépouillée et franche des reliefs hercyniens, de la Bretagne, des Ardennes, des plateaux de l'Aubrac et du Cézallier. Il était l'homme des marges, de l'entre-deux, des zones insolites, à la manière dont les surréalistes désignaient les hasards objectifs pourvoyeurs de « merveilles », qui, parfois, lui octroyaient des « extases » ressemblant étrangement à des expériences mystiques orientales, ou à ce que recherchait Heidegger, quand il parlait des « Clairières de l'être ». Mais s'il s'inspire beaucoup du romantisme allemand, il n'en demeure pas moins un géographe. Comme Jünger, il observe la nature, les paysages, au moyen d'un double regard, de la conjugaison « kaléidoscopique », dit Jünger dans Le Cœur aventureux, d'une interprétation analytique claire et distincte, et d'une plongée « magique » dans le flux de sensations que le monde offre. Un œil scrutateur au cœur du maelström, en quelque sorte. A cette connaissance de lieux remarquables se mêlent également intimement des fragments vivants de souvenirs mythiques, culturels, historique, etc., aboutissant parfois à un état proche du rêve. Mais un rêve conscient.
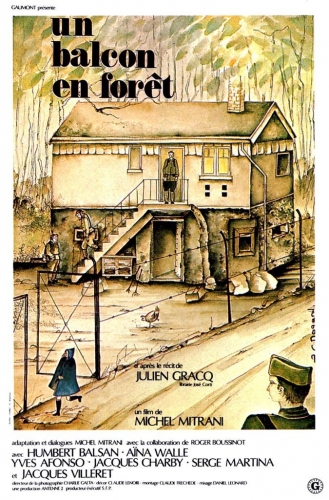
Gracq écrit à un moment où l'Occident est en crise, et le sait. Toute la production littéraire, philosophique, artistique du XXe siècle tente de répondre à ce malaise (et Freud, dans son Malaise dans la civilisation (1929), a réagi peu de temps après Spengler (1918 et 1922)). Gracq refuse de jouer. Il ne « s'engage » pas, il est, non « antipolitique », comme Baudelaire, qui s'essouffle à vilipender la démocratie, les bourgeois, l'égalitarisme, le progrès etc., mais apolitique. Non qu'il n'aille voter, mais il ne se laisse pas ferrer. Son royaume n'est pas de ce monde-là. Son « utopie », son locus amoenus, est de celui qui existe vraiment, qui est tel ou tel lieu, bien concret, bien sentant, bien jouissant, aussi prenant que des élans du cœur et de la chair, et qui ouvre sur le cosmos, dont l'ouverture délimite un périmètre aussi signifiant qu'une fenêtre découpant un paysage éblouissant de beauté convulsive ou gorgée de paix. Avec Gracq, comme avec d'autres (et comment ne pas penser à Kenneth White?), des contrées inconnues s'ouvrent à notre curiosité et à notre sensibilité : ce sont celles qui échappent aux labours de l'Histoire, et qui sont là, devant nos yeux, pourvu qu'on les ait « bien ouverts ».